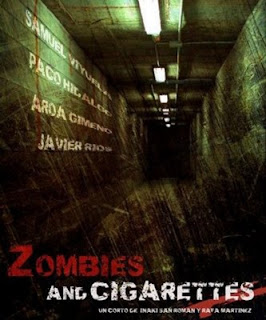Scare 2 Die est un film à sketchs dont le moteur est le surnaturel. On retrouve en ce sens la construction d’œuvres telles que Creepshow ou l’adaptation cinématographique de la série Tales Of The Darkside (que les fans de Tales From The Crypt doivent apprécier). Le réalisateur, Cub Chin, qui signe là son deuxième film, n’est ni un débutant dans l’industrie (il est scénariste et assistant réalisateur depuis 1985), ni un novice en matière de fantastique (il a notamment été assistant réalisateur sur l’ambitieux, prétentieux et décevant Night Corridors mettant en vedette Daniel Wu). Ici, il tient aussi bien la caméra que le stylo, puisqu’il est également scénariste.
Il est difficile de critiquer Scare 2 Die comme un ensemble, puisque chacun des segments est très différent, tant dans son approche que du point de vue technique. La première histoire se déroule dans l’univers du mahjong underground. Il est question d’usuriers menaçants, de course contre la montre, et d’une pièce magique qui permet, une fois par jour, d’avoir une combinaison parfaite et imparable. Seulement, il faut exécuter cette combinaison 13 fois sur 13 jours. Pas moins, et certainement pas plus. Sam Lee interprète notre protagoniste un rien pathétique. Le récit se veut cynique et ironique, mais ce second degré est surligné de façon insultante par le jeu cabotin de l’acteur et les gros effets qui tâchent. Visuellement, ce segment bénéficie d’expérimentations très intéressantes. On débute par une série de travellings en caméra à l’épaule dans les rues de Hong Kong la nuit. S’ensuit un générique qui enchaîne les flashs agressifs, avant de nous introduire une partie de majhong par le biais de travelling lents et plus esthétiques. Retour à notre scène de départ, et on comprend que la caméra s’accorde à la démarche peu assurée d’un Sam Lee pas si innocent. Face caméra, l’acteur va se cogner en plein objectif, défiant le mur de la réalité. Ces petites touches favorisent l’immersion dans un récit peu passionnant. La petite demi-heure insiste en effet beaucoup trop sur les parties de mahjong, alors qu’on a rapidement compris le concept de la pièce offerte pas un vieillard crachant du sang. Bien sûr, l’histoire jour sur les motifs récurrents, sur la répétition jusqu’à saturation, mais ce procédé atteint rapidement ses limites et ne suffit pas à combler le vide, à tel point qu’un récit de 30 minutes parvient à ennuyer. Quelques clins d’œil, comme le travelling sur la sirène d’ambulance, identique à celui de l’introduction alternative de Hard Boiled font sourire, tout comme certaines situations dégoutantes (un immonde bonhomme qui s’étouffe horriblement avec une glace à la vanille….). Mais l’originalité n’est pas au rendez-vous. Un constat particulièrement frappant lors des différentes morts, qui se ressemblent toutes. Quelques éclats de violence ne surprennent pas (la spa a dû crier au scandale, mais cette scène était prévisible) mais réjouissent, comme ce final très graphique mais peu profond. Un premier segment techniquement réussi, à la photographie léchée (même si on est loin du travail admirable de Johnnie To quand il s’agit de filmer Hong Kong la nuit), à la violence amusante, mais tellement creux…
La deuxième histoire est la plus ambitieuse du film, non pas en terme de scénario à proprement parler, mais en terme de structure narrative. Reprenant le concept déconcertant qui ouvre What Price Survival de Daniel Lee, le récit débute par un montage fiévreux, digne d’un Dead Or Alive, qui enchaîne les séquences chocs, les retours arrière et autres effets presque clippesques. On sent une volonté de ne pas laisser au spectateur la possibilité de créer ses repères. On pense également au surprenant Slipstream, réalisé et interprété par sir Anthony Hopkins. Mais contrairement au film de Daniel Lee, cet enchaînement présente les scènes à venir dans l’ordre chronologique. Un choix finalement peu judicieux. Après l’ivresse provoquée par cette introduction, le déroulement plus lent de l’histoire perd de son intérêt et le rythme s’en ressent. Pourquoi nous raconter en 15 minutes exactement la même chose que ce qui nous a marqués en 2 minutes ? Peut être parce que pour justifier la sortie en salle, il faut une durée minimale et qu’en l’état, le film atteint déjà à peine 1 heure 19. Cannibales ou zombies ? Difficile à dire, puisque le maquillage est minimaliste. Le doute persiste, néanmoins à cause de la réaction à la douleur. Malgré tout, la démarche et le regard vide des assaillants (forts peu nombreux au demeurant) instille le doute. L’isolement de l’héroïne est en tout cas très palpable, et l’une des bonnes idées de ce segment est de rester minimaliste en termes de dialogues, puisqu’il ne doit y avoir que 2 ou 3 paroles sur 20 minutes. Ici aussi on a droit à un peu d’adrénaline et à quelques scènes chocs, sans qu’on comprenne réellement leur intérêt d’ailleurs, comme ce passage où notre protagoniste semble se recoudre l’estomac… Lorsque le troisième segment démarre, on a le sentiment que cette histoire de zombies a fini avant même de commencer, dommage.
C’est Tommy Yuen, du groupe E-kids qui prend la relève pour une sombre histoire de tv-réalité. On y retrouve subrepticement quelques personnages de la première histoire, le temps passé dans des ascenseurs ou des escaliers correspond à au moins 1/3 de cette partie (plus le temps passé dans des couloirs), et le jeune Tommy a bien du mal à convaincre. Le montage est plus calme, mais on a tout de même droit à quelques images surréalistes, comme cette paire de jambes enchainées en surimpression. Ce segment reste le moins intéressant, que ce soit techniquement ou narrativement. Il clôt difficilement un film qui ressemble plus à une expérimentation du style Dead End Run de Sogo Ishii. Du style, mais peu de substance.
mercredi 27 octobre 2010
lundi 25 octobre 2010
zombies and cigarettes
Les zombies sont partout. Rien d’étonnant pour quiconque a lu Max Brooks. La rapidité de la contagion favorise largement l’étendue mondiale de l’infection. Cette fois, c’est en Espagne qu’une épidémie se déclare, le temps d’un court métrage de 15 minutes. Le décor ne perdra pas les fans du jeu « Dead Rising » premier du nom. Le couloir où débute l’intrigue est identique à celui reliant le hangar au centre commercial dans le jeu, et ce à la brique près. Les personnages, couverts de sang, sont armés de battes de baseball. Un flashback se propose de nous raconter comment les choses ont commencé. Tout semble donc débuter sous les meilleurs auspices.
Le centre commercial où ont lieu les événements ressemble beaucoup à celui du jeu de Capcom, même en dehors de son couloir aux briques blanches. La présentation des quelques protagonistes est brève, mais ils sont suffisamment stéréotypés pour que ça suffise. On est immédiatement surpris par la qualité de la photographie, au rendu très travaillé. Puis rapidement, les choix de mise en scène sèment le trouble. Est-il justifié de jouer les Paul Greengrass en herbe, caméra à l’épaule tremblante et gros plans à l’appui, pour filmer un personnage qui ramasse un flacon de parfum ? L’illisibilité d’une action tellement simple est aussi gratuite qu’inquiétante (non pas qu'on ait peur, mais parce que les actions plus complexes risquent d'être difficiles à voir).
La première attaque arrive vite, mais les tics de mise en scène déjà perceptibles atteignent les frontières du mauvais goût, pas celui qui caractérisait les premiers films de Peter Jackson, mais plutôt celui des mauvais téléfilms de l’après midi, et on ne voit strictement rien. Il semble que les zombies courent et plongent, mais il est difficile de l’affirmer à ce moment de l’histoire, puisqu’on a peine à distinguer ce qui se passe. Cette frustration est un peu compensée par des plans de cadavres au maquillage très convaincant. Qu’il s’agisse des visages de zombies ou des blessures, le travail est très soigné.
Vient alors le temps de la fuite, et même de l’échappée héroïque. Les acteurs font brièvement semblant de tirer, 2 ou 3 gifles fusent, puis on découvre que les zombies prennent feu au contact du parfum. On a vu nombre d’idées au fil des décennies, tant pour expliquer la cause de la contagion que pour aboutir à une issue positive. Mais cette utilisation du parfum est ridicule, et sans cohérence. L’utilisation de l’alcool dans « Poultrygeist, night of the chicken dead » se justifiait par un discours satyrique sur les fast food et le clin d’œil à l’eau de feu qui fut un facteur de la chute des nobles indiens (mais aussi du clergé et du tiers état), mais ici, l’idée semble un peu gratuite.
Après cette découverte, les héros encore en vie (certains ayant été massacrés en…. Hors champ !!!!!) se préparent à défendre leur vie….. avant de découvrir qu’il n’y a plus de zombies et que tout s’est passé…. Hors caméra !!!!! N’oublions pas la morsure de l’héroïne, qui n’a aucune incidence sur l’histoire, ni sur le happy end, puisqu’il semble qu’elle ne risque pas d’être contaminée (rien ne l’indique en tout cas). « Zombies and cigarettes » est un court métrage bourré de potentiel mais qui malheureusement ne parvient pas à le développer autant qu'il le pourrait. S'ensuit une déception inévitable, mais on ne peut qu'espérer que les éléments positifs seonrt davantage mis en valeur dans un prochain film.
Le centre commercial où ont lieu les événements ressemble beaucoup à celui du jeu de Capcom, même en dehors de son couloir aux briques blanches. La présentation des quelques protagonistes est brève, mais ils sont suffisamment stéréotypés pour que ça suffise. On est immédiatement surpris par la qualité de la photographie, au rendu très travaillé. Puis rapidement, les choix de mise en scène sèment le trouble. Est-il justifié de jouer les Paul Greengrass en herbe, caméra à l’épaule tremblante et gros plans à l’appui, pour filmer un personnage qui ramasse un flacon de parfum ? L’illisibilité d’une action tellement simple est aussi gratuite qu’inquiétante (non pas qu'on ait peur, mais parce que les actions plus complexes risquent d'être difficiles à voir).
La première attaque arrive vite, mais les tics de mise en scène déjà perceptibles atteignent les frontières du mauvais goût, pas celui qui caractérisait les premiers films de Peter Jackson, mais plutôt celui des mauvais téléfilms de l’après midi, et on ne voit strictement rien. Il semble que les zombies courent et plongent, mais il est difficile de l’affirmer à ce moment de l’histoire, puisqu’on a peine à distinguer ce qui se passe. Cette frustration est un peu compensée par des plans de cadavres au maquillage très convaincant. Qu’il s’agisse des visages de zombies ou des blessures, le travail est très soigné.
Vient alors le temps de la fuite, et même de l’échappée héroïque. Les acteurs font brièvement semblant de tirer, 2 ou 3 gifles fusent, puis on découvre que les zombies prennent feu au contact du parfum. On a vu nombre d’idées au fil des décennies, tant pour expliquer la cause de la contagion que pour aboutir à une issue positive. Mais cette utilisation du parfum est ridicule, et sans cohérence. L’utilisation de l’alcool dans « Poultrygeist, night of the chicken dead » se justifiait par un discours satyrique sur les fast food et le clin d’œil à l’eau de feu qui fut un facteur de la chute des nobles indiens (mais aussi du clergé et du tiers état), mais ici, l’idée semble un peu gratuite.
Après cette découverte, les héros encore en vie (certains ayant été massacrés en…. Hors champ !!!!!) se préparent à défendre leur vie….. avant de découvrir qu’il n’y a plus de zombies et que tout s’est passé…. Hors caméra !!!!! N’oublions pas la morsure de l’héroïne, qui n’a aucune incidence sur l’histoire, ni sur le happy end, puisqu’il semble qu’elle ne risque pas d’être contaminée (rien ne l’indique en tout cas). « Zombies and cigarettes » est un court métrage bourré de potentiel mais qui malheureusement ne parvient pas à le développer autant qu'il le pourrait. S'ensuit une déception inévitable, mais on ne peut qu'espérer que les éléments positifs seonrt davantage mis en valeur dans un prochain film.
samedi 23 octobre 2010
Barely political, un phénomène youtube
Internet a ouvert la porte à la création artistique. Ce n’est pas du goût de tout le monde, mais chacun peut désormais s’exprimer et prétendre apporter sa contribution au monde de l’art, avec plus ou moins de soins, évidemment. Si les courts métrages faits à la va vite pullulent, certains groupes témoignent continuellement non seulement d’une imagination débordante, mais aussi d’une ingéniosité impressionnante.
En tant que fan de Batman, c’est en cherchant des vidéos mettant en scène le chevalier noir que j’ai découvert Barelypolitical. http://www.youtube.com/watch?v=ks8PZ8X6Yo8. On y découvre un héros trop occupé à se jouer lui-même dans Mortal Kombat Vs Dc Universe pour combattre le crime. Cette vidéo ne bénéficie pas de gros effets et n’essaie pas d’impressionner le spectateur par des scènes d’action virevoltantes. En revanche, les relations entre les protagonistes sont tout à fait dans l’esprit, et l’humour fonctionne de façon percutante.
L’interprète du rôle, Mark Douglas, est la tête pensante du groupe. Il écrit les scénarios, rédige les paroles des chansons, et bien souvent interprète le rôle principal, avec beaucoup de talent. L’an dernier, le groupe parvenait à sortir une chanson parodique chaque semaine, et même si ce rythme a ralenti depuis, la qualité est presque toujours constante. Les personnages de comics sont souvent exploités, puisque Batman intervient régulièrement, notamment dans un rap sur le film The Dark Knight, où Mark interprète tous les rôles avec beaucoup de talent :
http://www.youtube.com/watch?v=vbgLapRAloQ&feature=&p=DB31CCE302A37BAE&index=0&playnext=1.
L’une des vidéos les plus drôles a été faite en collaboration avec Indymogul, un groupe qui met un point d’honneur a nous initier aux techniques de trucages employées dans les films d’horreur notamment. Il s’agit du résultat qu’aurait donné le film de Gavin Hood X-men Origins : wolverine, s’il avait été réalisé sous forme de comédie musicale. C’est une fois de plus Mark Douglas qui interprète le rôle titre où il prouve ses talents de chanteur le temps de trois chansons qui retracent le parcours du personnage de façon hilarante : http://www.youtube.com/watch?v=BFutWATCPg0.
Les choix de parodies sont généralement justifiés par l’actualité médiatique, et les jeux vidéos ne sont donc pas en reste, Mario Bros ayant droit à quelques vidéos qui prennent un malin plaisir à se moquer des stéréotypes sur les italiens… avant de les réexploiter encore plus brutalement !
http://www.youtube.com/watch?v=Q0MrrBXEJ1U&feature=channel
Dans le même ordre d’idée, on verra les beatles évoluer dans le jeu d’infectés Left 4 dead, même s’il ne s’agit pas de la vidéo la plus mémorable. http://www.youtube.com/watch?v=mjuTJB2MiIc
Comme le nom du groupe l’indique, la politique n’est pas absente du propos, puisque c’est en filmant Obama Girl chanter son amour pour l’actuel président, à l’époque où il n’était encore que candidat que la reconnaissance a débuté :
http://www.youtube.com/watch?v=wKsoXHYICqU.
Mais finalement, les cibles privilégiées de Barelypolitical sont bel et bien les séries tv, les émissions, les acteurs et les chanteurs du moment. La mode de la tv-réalité est loin d’être terminée, en particulier aux Etats-Unis, avec des émissions comme Jersey Shore, dont le concept est cette fois expliquée avec un œil féroce par le boss, Bruce Springsteen : http://www.youtube.com/watch?v=EyBwZeoxISk
La fameuse série 24, mettant en scène Kieffer Sutherland dans le rôle d’un super agent, Jack Bauer est l’occasion de souligner l’attitude un peu excessive de certains fans : http://www.youtube.com/watch?v=AuzPN_8GwYA&feature=watch_response.
Dernièrement, c’est le phénomène Glee qui a été attaqué par l’équipe, dans une vidéo qui est, à mon sens, l’une de leurs plus grandes réussites, où Michael Jackson, qui découvre le programme du paradis, décide de passer à l’attaque en voyant ses tubes massacrés, avec ses hordes de zombies débarquées de Thriller : http://www.youtube.com/watch?v=sBGFpy-DYXA.
Certains films sont tellement intégrés dans notre époque, et, indépendamment du fait qu’on les aime ou non, ont tellement marqué une génération qu’ils ne peuvent échapper au regard de Barelypolitical, tel le phénomène twilight, remis en perspective dans le cadre du mythe de zombie le temps d’une chanson qui mélange habilement la saga de Stéphanie Meyer avec une vision plus traditionnelle, et une ambiance typique des films d’épouvante des deux premiers tiers du 20 siècle : http://www.youtube.com/watch?v=1glNuQiE77E.
Si toutes les vidéos ne sont pas des chansons, c’est le support qui est privilégié par l’équipe, ce qui s’avère très pratique pour se moquer de la génération actuelle (gentiment tout de même). La révélation de l’émission American Idol, Adam Lambert, dont les frasques sont décriées par les familles conservatrices, sont reprises dans une parodie de la chanson Whaddaya want from me : http://www.youtube.com/watch?v=oEDgmgbXm-E
Enfin, le jeune prodige Justin Bieber (qui incarnera Robin dans le troisième Batman de Christopher Nolan, d’où le surnom… vous y avez cru hein !) a trouvé un imitateur au jeu inimitable, le temps de quelques chansons inoubliables. Voilà la première : http://www.youtube.com/watch?v=W_cGo0q7krk
Et la seconde, dans la musique devrait rappeler des souvenirs aux fans : http://www.youtube.com/watch?v=zHzN80iC59I.
Enfin, Eminem a trouvé son sosie parfait en la personne de Mark Douglas, comme le prouvent ces parodies de Not Afraid : http://www.youtube.com/watch?v=h9pFPOI8ecw et du duo avec Rihanna (c’est d’ailleurs l’épouse de Mark Douglas qui chante) Love The Way You Lie : http://www.youtube.com/watch?v=6dNryy5elc8.
L’équipe a un rythme moins appuyé actuellement, ce qui est compréhensible quand on voit le nombre de parodies qu’elle a réalisé avec succès, mais le travail est toujours de grande qualité, et on ne peut qu’espérer que le concept de Key Of Awesome continue à nous divertir durant de nombreuses années encore ! Voilà un abonnement que je ne regrette pas en tout cas !
En tant que fan de Batman, c’est en cherchant des vidéos mettant en scène le chevalier noir que j’ai découvert Barelypolitical. http://www.youtube.com/watch?v=ks8PZ8X6Yo8. On y découvre un héros trop occupé à se jouer lui-même dans Mortal Kombat Vs Dc Universe pour combattre le crime. Cette vidéo ne bénéficie pas de gros effets et n’essaie pas d’impressionner le spectateur par des scènes d’action virevoltantes. En revanche, les relations entre les protagonistes sont tout à fait dans l’esprit, et l’humour fonctionne de façon percutante.
L’interprète du rôle, Mark Douglas, est la tête pensante du groupe. Il écrit les scénarios, rédige les paroles des chansons, et bien souvent interprète le rôle principal, avec beaucoup de talent. L’an dernier, le groupe parvenait à sortir une chanson parodique chaque semaine, et même si ce rythme a ralenti depuis, la qualité est presque toujours constante. Les personnages de comics sont souvent exploités, puisque Batman intervient régulièrement, notamment dans un rap sur le film The Dark Knight, où Mark interprète tous les rôles avec beaucoup de talent :
http://www.youtube.com/watch?v=vbgLapRAloQ&feature=&p=DB31CCE302A37BAE&index=0&playnext=1.
L’une des vidéos les plus drôles a été faite en collaboration avec Indymogul, un groupe qui met un point d’honneur a nous initier aux techniques de trucages employées dans les films d’horreur notamment. Il s’agit du résultat qu’aurait donné le film de Gavin Hood X-men Origins : wolverine, s’il avait été réalisé sous forme de comédie musicale. C’est une fois de plus Mark Douglas qui interprète le rôle titre où il prouve ses talents de chanteur le temps de trois chansons qui retracent le parcours du personnage de façon hilarante : http://www.youtube.com/watch?v=BFutWATCPg0.
Les choix de parodies sont généralement justifiés par l’actualité médiatique, et les jeux vidéos ne sont donc pas en reste, Mario Bros ayant droit à quelques vidéos qui prennent un malin plaisir à se moquer des stéréotypes sur les italiens… avant de les réexploiter encore plus brutalement !
http://www.youtube.com/watch?v=Q0MrrBXEJ1U&feature=channel
Dans le même ordre d’idée, on verra les beatles évoluer dans le jeu d’infectés Left 4 dead, même s’il ne s’agit pas de la vidéo la plus mémorable. http://www.youtube.com/watch?v=mjuTJB2MiIc
Comme le nom du groupe l’indique, la politique n’est pas absente du propos, puisque c’est en filmant Obama Girl chanter son amour pour l’actuel président, à l’époque où il n’était encore que candidat que la reconnaissance a débuté :
http://www.youtube.com/watch?v=wKsoXHYICqU.
Mais finalement, les cibles privilégiées de Barelypolitical sont bel et bien les séries tv, les émissions, les acteurs et les chanteurs du moment. La mode de la tv-réalité est loin d’être terminée, en particulier aux Etats-Unis, avec des émissions comme Jersey Shore, dont le concept est cette fois expliquée avec un œil féroce par le boss, Bruce Springsteen : http://www.youtube.com/watch?v=EyBwZeoxISk
La fameuse série 24, mettant en scène Kieffer Sutherland dans le rôle d’un super agent, Jack Bauer est l’occasion de souligner l’attitude un peu excessive de certains fans : http://www.youtube.com/watch?v=AuzPN_8GwYA&feature=watch_response.
Dernièrement, c’est le phénomène Glee qui a été attaqué par l’équipe, dans une vidéo qui est, à mon sens, l’une de leurs plus grandes réussites, où Michael Jackson, qui découvre le programme du paradis, décide de passer à l’attaque en voyant ses tubes massacrés, avec ses hordes de zombies débarquées de Thriller : http://www.youtube.com/watch?v=sBGFpy-DYXA.
Certains films sont tellement intégrés dans notre époque, et, indépendamment du fait qu’on les aime ou non, ont tellement marqué une génération qu’ils ne peuvent échapper au regard de Barelypolitical, tel le phénomène twilight, remis en perspective dans le cadre du mythe de zombie le temps d’une chanson qui mélange habilement la saga de Stéphanie Meyer avec une vision plus traditionnelle, et une ambiance typique des films d’épouvante des deux premiers tiers du 20 siècle : http://www.youtube.com/watch?v=1glNuQiE77E.
Si toutes les vidéos ne sont pas des chansons, c’est le support qui est privilégié par l’équipe, ce qui s’avère très pratique pour se moquer de la génération actuelle (gentiment tout de même). La révélation de l’émission American Idol, Adam Lambert, dont les frasques sont décriées par les familles conservatrices, sont reprises dans une parodie de la chanson Whaddaya want from me : http://www.youtube.com/watch?v=oEDgmgbXm-E
Enfin, le jeune prodige Justin Bieber (qui incarnera Robin dans le troisième Batman de Christopher Nolan, d’où le surnom… vous y avez cru hein !) a trouvé un imitateur au jeu inimitable, le temps de quelques chansons inoubliables. Voilà la première : http://www.youtube.com/watch?v=W_cGo0q7krk
Et la seconde, dans la musique devrait rappeler des souvenirs aux fans : http://www.youtube.com/watch?v=zHzN80iC59I.
Enfin, Eminem a trouvé son sosie parfait en la personne de Mark Douglas, comme le prouvent ces parodies de Not Afraid : http://www.youtube.com/watch?v=h9pFPOI8ecw et du duo avec Rihanna (c’est d’ailleurs l’épouse de Mark Douglas qui chante) Love The Way You Lie : http://www.youtube.com/watch?v=6dNryy5elc8.
L’équipe a un rythme moins appuyé actuellement, ce qui est compréhensible quand on voit le nombre de parodies qu’elle a réalisé avec succès, mais le travail est toujours de grande qualité, et on ne peut qu’espérer que le concept de Key Of Awesome continue à nous divertir durant de nombreuses années encore ! Voilà un abonnement que je ne regrette pas en tout cas !
vendredi 22 octobre 2010
Fantastic Four 1234 par Grant Morrison et Jae Lee
Le cinéma a le film choral, avec ses personnages au destin unique, qui se croise, et dont, parfois, la route se rencontre brièvement. « Fantastic Four 123 » n’est pas un film, et les protagonistes se connaissent, mais la structure du récit évoque ce style de cinéma. 4 héros, 4 épisodes, 4 destins, toujours intimement liés, malgré 4 caractères si différents. Les conflits puérils entre la chose et la torche ont toujours donné un peu de sel à la série, tandis que les disputes entre Sue et Reed Richards rythment les aventures cosmiques, parfois avec suffisamment de violence pour que le lecteur s’inquiète de l’avenir du couple, à la manière d’un Homer Simpson cherchant à se faire pardonner de Marge après avoir fait une trop grosse bêtise.
Cette fois, il n’est pas question de voyager dans l’espace pour sauver l’humanité, ou de préparer la défense de la terre contre Galactus. Le récit tout entier se nourrit de l’aspect intimiste qui définit cette famille extraordinaire. Car à la manière des X-men (certaines de leurs incarnations du moins) les 4 fantastiques sont plus une famille qu’une équipe. Un constat qui n’a pas échappé à l’auteur écossais et prolifique Grant Morrison. Le premier épisode nous montre un Ben Grimm (AKA la chose) dans un état d’esprit qui n’est pas sans rappeler Bruce Wayne lorsqu’il effectue sa visite annuelle de crime alley. Espérant opérer un retour au source, le héros à l’allure monstrueuse se rend dans le quartier de son enfance, et, en voulant aider à sa manière un peu bourrue les autorités, va s’attirer les foudres la population.
On ne peut s’empêcher de ressentir une atmosphère pesante liée au traumatisme du 11 septembre, d’où un sentiment de crise omniprésent. La tension entre les différents personnages est palpable et devient aussi étouffante pour le lecteur que pour eux. L’utilisation d’éclairs sur fond de ciel rouge n’est pas sans rappeler ce motif récurrent utilisé par Morrison pour « Batman Rip » et « Final Crisis ». Tous ces éléments font de « fantastic four 1234 » une œuvre mature, dénuée de l’aspect cartoon que l’on peut parfois associer à la série. Le format Marvel Knights n’est d’ailleurs sans doute pas étranger à ce parti-pris. Rapidement, l’aspect super-héroïque, déjà plus évoqué que réellement montré, cède le pas à l’horreur lorsque Ben Grimm se laisse piéger par son désir d’être, et de ne plus être une chose. Visuellement cette scène est aussi puissante que poignante, évitant les artifices grossiers. C’est justement cette sobriété qui donne toute sa force à ce passage perturbant, très proche d’un « Johnny s’en va en guerre », et rappelant furieusement le cauchemar qu’était « L’échelle de Jacob ».
L’alternance des points de vue confère un rythme entrainant, les situations des uns faisant écho à celle des autres. Entre un Ben Grimm au bout du rouleau, son chemin de croix rappelant cruellement sa lutte quotidienne, une Sue, prisonnière d’une relation conjugale parfois étouffante et frustrante, et un Johnny Storms partagé entre son désir de profiter de la vie et son amitié, chacun va devoir trouver comment se libérer de son fardeau sans les autres… ou pas, comme vient nous le rappeler l’utilisation visuelle répétée du 4, symbole de l’équipe…
Au final, « Fantastic Four 1234 » n’est peut être pas une œuvre inoubliable, mais sa mélancolie, sa réflexion introspective et ses personnages attachants en font une lecture excellente.
Cette fois, il n’est pas question de voyager dans l’espace pour sauver l’humanité, ou de préparer la défense de la terre contre Galactus. Le récit tout entier se nourrit de l’aspect intimiste qui définit cette famille extraordinaire. Car à la manière des X-men (certaines de leurs incarnations du moins) les 4 fantastiques sont plus une famille qu’une équipe. Un constat qui n’a pas échappé à l’auteur écossais et prolifique Grant Morrison. Le premier épisode nous montre un Ben Grimm (AKA la chose) dans un état d’esprit qui n’est pas sans rappeler Bruce Wayne lorsqu’il effectue sa visite annuelle de crime alley. Espérant opérer un retour au source, le héros à l’allure monstrueuse se rend dans le quartier de son enfance, et, en voulant aider à sa manière un peu bourrue les autorités, va s’attirer les foudres la population.
Si l’équipe a toujours été considérée comme plus ou moins populaire auprès de la population, la chose a toujours été le vilain petit canard du groupe. Au-delà de son apparence, c’est son côté cynique et ses manières un peu rustique qui ne lui ont jamais permis d’aspirer à la popularité du charmeur Johnny Storm ou du brillant Reed Richards. Cette entrée en matière, mélange de mélancolie, de rancœur et de solitude est illustré avec efficacité par Jae Lee. Le dessinateur est parfait pour retranscrire les atmosphères sombres, voire sinistres. Le côté statique de ses dessins illustre très bien l’inertie de personnage écrasés par leur sort, en particulier lorsqu’il s’agit de montrer la chose avec le moral dans les chaussettes (du moins s’il en portait).
Chaque épisode étant dédié à l’un des personnages, l’ambiance va être radicalement différente par la suite. Finies les cadres horrifiques mais réalistes, même si la mélancolie est encore très présente. Et si Reed Richards ne sera que peu présent jusqu’au dernier épisode, les autres personnages apparaissent régulièrement, même si leur arc narratif est défini principalement par un épisode. Le côté cinématographique appuyé va prendre une tournure différente, avec un découpage plus proche des standards actuels de série tv. Une discussion entre Sue et Alicia Masters sera notamment ponctuée de gros plans détaillant l’évolution des actions. Et si les problèmes que rencontrent les protagonistes sont très humains, c’est aussi parce que les petites touches d’humour viennent dédramatiser un ensemble qui pourrait rapidement virer au mélodrame de soap opéra.
Thématiquement, le récit est donc très riche, mettant en perspective les actes « héroïques » de nos protagonistes par le biais d’un antagoniste qui pourrait être davantage que victime qu’on pourrait le croire. Ce discours à la limite du nihilisme apporte beaucoup de profondeurs aux actes des personnages, et on comprend que chacun a des motivations aussi uniques que crédibles. 1234 est davantage une introspection, voire une psychothérapie familiale qu’un récit d’action. Certaines idées sont non seulement brillantes, mais illustrées avec beaucoup d’audace et d’efficacité, comme la prise de conscience de Ben Grimm, au découpage frénétique, qui donne une impression de relief puissante, et où la notion de combat prend un sens tout à fait différent de ce qu’on s’attendrait à voir. La claustrophobie générale et la non vie que l’on ressent parfois sont également contrebalancées par des sursauts de volonté et quelques retournements de situation justifiés par un emploi très cohérent des seconds rôles.
Quand vient enfin l’heure des règlements de comptes, et que le grand héros, le génie Reed Richards daigne enfin se montrer, le suspense est à son comble. Est-il suffisamment intelligent pour imaginer, dans le peu de temps à sa disposition, un plan lui permettant de sauver sa famille en pleine déliquescence ? Et le héros en est-il vraiment un ? Le récit nous fait douter avec maestria, et les suggestions qui sont faites apportent une épaisseur bienvenue aux personnages.
mercredi 20 octobre 2010
Trailer Park Of Terror
Voilà un de ces films où les victimes servent réellement de chair à canon et où les antagonistes sont plus intéressants. On a un peu l’impression de voir un mélange de « House of 1000 Corpses » et sa suite « Devil’s Reject » de Rob Zombie. « Trailer Park Of Terror » partage avec ces deux films une parenté évidente avec le « 1000 maniacs » de Herschell Gordon Lewis (le pape du gore) qui est d’ailleurs directement cité dans la scène d’ouverture. Un héritage qui ne garantit pas une nomination aux oscars mais qui assure un divertissement aussi décalé que coloré (de rouge…), dans la plus pure tradition du grand guignol dont est issu le gore. Il s'agit également de l'adaptation d'un comic du même nom.
L’introduction met largement en avant ce côté plouc, et la notion de consanguinité est également abordée. C’est Norma, une jeune femme vivant sur place, qui nous permet de rencontrer les autochtones. Vilain petit canard rêvant de s’enfuir, elle sera confrontée une fois de trop à la violence, lorsque son charmant petit ami sera ‘accidentellement) transpercé par les piques d’un portail. Cette première mort est graphique et prouve que la violence ne se déroulera pas hors champ. Ce parti-pris, associé à une maîtrise technique évidente font de « Trailer Park Of Terror » un film réjouissant plutôt que l’une de ces innombrables séries Z que l’amateur de gore et de zombies est inévitablement amené à rencontrer. La photographie est esthétique sans être excessivement léchée, la caméra est mobile (on notera d’ailleurs l’emploi d’une grue, et les travellings sont très réussis) et le montage ne perd jamais le spectateur. Visuellement, le film est une réussite et offre une profusion d’effets gores aussi jouissifs que convaincants.
Les agresseurs sont à présent des morts vivants, à la peau décharnée, voire moisie, aux os apparents, et au physique de zombies (ce qu’ils sont). Mais ils ont toujours les capacités de réflexion et de parole, ce qui permettra des échanges savoureux. Ce choix scénaristique permet justement l’inventivité des attaques, qui dépassent le cadre de la simple attaque de dents. Entre un rocker, une obèse affamée et de démoniaques pervers, nos monstres ont de quoi réjouir les fans. N’oublions pas une séance de massage asiatique destinée à rester dans les annales….
Aussi sympathique que conseillé !

L’intrigue se déroule presque exclusivement dans le camp de caravanes du titre, occupé par des individus qui auraient tout à fait leur place dans la galerie des monstres d’un cirque. Mais avant d’être des freaks, des bêtes de foire, les habitants sont des rednecks (l’équivalent américain du plouc ou du péquenaud). Le redneck, ignorant et violent, est un agresseur souvent employé : « deliverance », « Day Of The Woman » (aussi connu sous le titre « I Spit On Your Grave », dont le remake est d’ailleurs en préparation) ou « Texas Chainsaw Massacre » pour ne citer qu’eux, on fait de l’habitant de la campagne profonde un être abject, prompte à tirer avant de parler, à violer et à torturer… une figure menaçante car elle existe, qu’on peut la croiser pendant les vacances hors de la ville, et que son style de vie ne correspond plus à la norme actuelle d’un pays réputé pour la richesse de ses zones les plus urbaines.
On constate que l’équipe veut sincèrement offrir un spectacle de qualités aux spectateurs, et le massacre qui clôt les 10 premières minutes d’introduction, malgré son aspect un peu soft (l’hémoglobine ne jaillit pas encore de toutes parts) remporte l’adhésion.
En quelques minutes, le cadre est planté, l’ambiance installée, et l’incursion du surnaturel (du diabolique ??) achève d’assurer que la mort sera joyeusement de la partie. Les événements s’enchainent tellement bien lors de ces premières minutes qu’ils auraient pu faire un très bon épisode des « Contes De La Crypte ». Lorsqu’on a le loisir de contempler les cadavres, on constate que les maquillages sont vraiment réussis. Puis un bang va permettre à l’intrigue de vraiment démarrer. Les futures victimes sont rapidement présentées avant d’être envoyées en enfer. Jeunes à problèmes emmenés sur le chemin de la rédemption par un pasteur, les protagonistes sont des caricatures, mais on ne leur en demande pas davantage et c’est avec plaisir qu’on attend de les voir se faire massacrer.
Leur confrontation à l’horreur n’est pas directe, mais la scène du flashback qui leur est contée suffit à sceller leur sort dans cet univers glauque. L’ambiance n’est malgré tout pas totalement malsaine, grâce à un second degré bienvenu qui évite de verser dans le slasher pour adolescents trop sérieux. La première heure est un peu avare en morts (si on oublie l’introduction) mais se suit sans ennui. Le dernier tiers est par contre bien plus généreux. C’est arrachage de tête à mains nues qui ouvre élégamment le bal dans un geyser de sang. Les mises à mort vont alors se montrer inventives, nos rednecks freaks zombies étant exploités en fonction de leurs spécificités. La diversité est au rendez-vous, et le massacre va s’étendre ingénieusement sur 20 minutes, instaurant du suspense sans jamais oublier l’humour.
Les agresseurs sont à présent des morts vivants, à la peau décharnée, voire moisie, aux os apparents, et au physique de zombies (ce qu’ils sont). Mais ils ont toujours les capacités de réflexion et de parole, ce qui permettra des échanges savoureux. Ce choix scénaristique permet justement l’inventivité des attaques, qui dépassent le cadre de la simple attaque de dents. Entre un rocker, une obèse affamée et de démoniaques pervers, nos monstres ont de quoi réjouir les fans. N’oublions pas une séance de massage asiatique destinée à rester dans les annales….
Lorsqu’arrive le générique de fin, on a la sensation d’avoir assisté à un spectacle grand guignol de qualité, hautement divertissant, où les zombies n’ont pas nécessairement toutes les caractéristiques classiques des morts vivants, sans que le plaisir soit trop diminué.


dimanche 17 octobre 2010
Silent Hill Origins
De 2007 à 2010, Konami a édité 3 jeux de la saga « Silent Hill ». Aucun n’a été créé par la Silent Team, responsable des 4 précédents opus. Seul le compositeur Akira Yamaoka a participé à ces 3 derniers épisodes.
Comme son nom l’indique, Origins se déroule avant les tribulations d’Harry Mason, héros du premier jeu. C’est la société anglaise Climax qui s’occupe de la conception (tout comme celle de « Silent Hill Shattered Memories »). On dit souvent que la première impression est la plus importante. Comme les autres opus, Origins happe le joueur dans son ambiance si particulière dès les premières scènes.
Notre protagoniste, Travis, est un routier obligé d’intervenir dans un drame qui le dépasse. La rencontre avec une petite fille mystérieuse le poussera à s’élancer dans une maison en flammes pour sauver une enfant carbonisée. Cette entrée en matière permettra à ceux qui ont terminé le 1er jeu de resituer la chronologie de l’intrigue immédiatement. On se retrouve alors à Silent Hill, où se déroulera la quasi intégralité de l’intrigue. On peut déjà constater que les cinématiques sont de qualité et que le moteur graphique est tout à fait convaincant. Les scènes dans les rues de Silent Hill bénéficient de l’opacité d’un brouillard peu rassurant, sans que le rendu ne soit excessif, comme c’était le cas dans « Silent Hill 3 ».
On retrouve rapidement quelques lieux connus, notamment l’hôpital. C’est un plaisir, mais on a aussi une impression de déjà vu qui hantera l’ensemble de l’expérience de jeu. On a la sensation que par souci de fidélité aux opus précédents, l’équipe a eu des difficultés à s’éloigner de ce qui avait déjà été fait, et pas seulement au niveau des lieux. Le personnage du boucher, qui déambulera fiévreusement à plusieurs reprises dans des scènes mémorables, rappelle fortement le pyramid head qui pourchassait James Sunderland dans le 2ème épisode. Même visuellement, Origins ne se distingue pas de ce qui a déjà été fait.
Tout n’est pas emprunté par contre. Pour commencer, Travis possède des poches qui doivent servir de portail sur une dimension parallèle. Comment expliquer en effet, qu’il parvienne à y introduire des télévisions, des bouteilles de plusieurs litres, et d’autres objets encombrants, sans que le poids ne le ralentisse ? On collecte des boissons de santé et objets rituels, mais aussi des objets du quotidien faisant office d’armes. Le système de combat est ainsi plus développé que dans les jeux précédents. Travis n’est pas un piquet, les commandes répondent immédiatement, et on peut même se battre à mains nues, fait unique dans la saga. Sans être aussi fluide que celle de « Silent Hill Homecoming », la jouabilité est donc bien meilleure qu’auparavant. Le système de caméras fixes est également mieux exploité, car l’action est presque toujours lisible. Bien sûr, on a toujours droit à certains passages où la caméra est face à nous, pour que les ennemis puissent nous surprendre, mais une fois qu’on les affronte, on les voit clairement, ce qui n’était pas toujours le cas dans les autres jeux.
L’autre apport inédit est lié à la dimension parallèle de Silent Hill. Alors qu’elle nous est imposée dans les autres jeux (exception faite de « Silent Hill 4 : The Room », mais il s’agit d’un cas différent), ici c’est au joueur d’ouvrir la brèche en utilisant des miroirs spéciaux. Bien sûr, le voyage est inévitable pour progresser dans les bâtiments et faire avancer l’intrigue (qui partage des points communs non négligeables avec celle d’un autre épisode dont je ne dévoilerai pas le numéro), ce parti-pris peut se justifier et approfondit l’idée de libre arbitre (dans une certaine mesure). La dimension parallèle est un peu décevante, car son aspect décadent n’est pas pleinement exploité. Bien sûr, la rouille propre à « l’autre » Silent Hill tapisse les couloirs, mais globalement, on a plus l’impression de visiter les mêmes lieux dans des teintes plus sépia que d’être envoyé dans une version infernale d’endroits connus.
L’angoisse est malgré tout présente, pour peu qu’on joue dans des conditions adaptées, dans l’obscurité et casque sur les oreilles. L’effet de surprise est parfois amoindri par les grésillements de radio qui préviennent de la proximité de monstres, mais il n’est pas rare de voir une créature se jeter sur nous en ouvrant une porte, ce qui n’est jamais rassurant. L’ambiance sonore, excellente, contribue une fois encore grandement à élever le niveau de stress. Entre les notes de musique mélancoliques, les bruits de métal qu’on cogne, les grincements divers et les grognements, nos oreilles et nos nerfs sont mis à rude épreuve. Mais au-delà de l’ambiance très (trop) fidèle à celle des autres opus, c’est l’intrigue qui donne tout son sens à ce « Silent Hill Origins ». On se situe davantage dans un voyage psychologique (et émotionnel) proche de celui de « Silent Hill 2 » que dans le mysticisme et l’occulte des épisodes 1 et 3. Il y a bien quelques références à l’ordre, et on croise plusieurs figures connues, mais elles sont là pour situer la chronologie plus que pour imprégner l’histoire d’éléments religieux prégnants.
La quête de Travis devient rapidement une enquête, pour comprendre ce qui l’amène à Silent Hill, puis pour comprendre qui il est. Tout comme dans le 3ème opus, il n’y a que deux fins différentes (plus une fin bonus), mais elles sont plus distinctes et apportent chacune un éclairage plus cohérent que celui du 3ème épisode (qui reste excellent), et la deuxième fin est aussi marquante que perturbante. Globalement, « Silent Hill Origins » est une bonne surprise. On prend plaisir à suivre les péripéties de Travis, et on a envie de découvrir avec lui les secrets que lui soumet la ville. Le voyage est un peu trop réminescent des autres épisodes, mais le traitement est fidèle, et l’ambiance excellente.
Comme son nom l’indique, Origins se déroule avant les tribulations d’Harry Mason, héros du premier jeu. C’est la société anglaise Climax qui s’occupe de la conception (tout comme celle de « Silent Hill Shattered Memories »). On dit souvent que la première impression est la plus importante. Comme les autres opus, Origins happe le joueur dans son ambiance si particulière dès les premières scènes.
On retrouve rapidement quelques lieux connus, notamment l’hôpital. C’est un plaisir, mais on a aussi une impression de déjà vu qui hantera l’ensemble de l’expérience de jeu. On a la sensation que par souci de fidélité aux opus précédents, l’équipe a eu des difficultés à s’éloigner de ce qui avait déjà été fait, et pas seulement au niveau des lieux. Le personnage du boucher, qui déambulera fiévreusement à plusieurs reprises dans des scènes mémorables, rappelle fortement le pyramid head qui pourchassait James Sunderland dans le 2ème épisode. Même visuellement, Origins ne se distingue pas de ce qui a déjà été fait.
Tout n’est pas emprunté par contre. Pour commencer, Travis possède des poches qui doivent servir de portail sur une dimension parallèle. Comment expliquer en effet, qu’il parvienne à y introduire des télévisions, des bouteilles de plusieurs litres, et d’autres objets encombrants, sans que le poids ne le ralentisse ? On collecte des boissons de santé et objets rituels, mais aussi des objets du quotidien faisant office d’armes. Le système de combat est ainsi plus développé que dans les jeux précédents. Travis n’est pas un piquet, les commandes répondent immédiatement, et on peut même se battre à mains nues, fait unique dans la saga. Sans être aussi fluide que celle de « Silent Hill Homecoming », la jouabilité est donc bien meilleure qu’auparavant. Le système de caméras fixes est également mieux exploité, car l’action est presque toujours lisible. Bien sûr, on a toujours droit à certains passages où la caméra est face à nous, pour que les ennemis puissent nous surprendre, mais une fois qu’on les affronte, on les voit clairement, ce qui n’était pas toujours le cas dans les autres jeux.
 |
| Non ce n'est pas Pyramid Head |
L’autre apport inédit est lié à la dimension parallèle de Silent Hill. Alors qu’elle nous est imposée dans les autres jeux (exception faite de « Silent Hill 4 : The Room », mais il s’agit d’un cas différent), ici c’est au joueur d’ouvrir la brèche en utilisant des miroirs spéciaux. Bien sûr, le voyage est inévitable pour progresser dans les bâtiments et faire avancer l’intrigue (qui partage des points communs non négligeables avec celle d’un autre épisode dont je ne dévoilerai pas le numéro), ce parti-pris peut se justifier et approfondit l’idée de libre arbitre (dans une certaine mesure). La dimension parallèle est un peu décevante, car son aspect décadent n’est pas pleinement exploité. Bien sûr, la rouille propre à « l’autre » Silent Hill tapisse les couloirs, mais globalement, on a plus l’impression de visiter les mêmes lieux dans des teintes plus sépia que d’être envoyé dans une version infernale d’endroits connus.
L’angoisse est malgré tout présente, pour peu qu’on joue dans des conditions adaptées, dans l’obscurité et casque sur les oreilles. L’effet de surprise est parfois amoindri par les grésillements de radio qui préviennent de la proximité de monstres, mais il n’est pas rare de voir une créature se jeter sur nous en ouvrant une porte, ce qui n’est jamais rassurant. L’ambiance sonore, excellente, contribue une fois encore grandement à élever le niveau de stress. Entre les notes de musique mélancoliques, les bruits de métal qu’on cogne, les grincements divers et les grognements, nos oreilles et nos nerfs sont mis à rude épreuve. Mais au-delà de l’ambiance très (trop) fidèle à celle des autres opus, c’est l’intrigue qui donne tout son sens à ce « Silent Hill Origins ». On se situe davantage dans un voyage psychologique (et émotionnel) proche de celui de « Silent Hill 2 » que dans le mysticisme et l’occulte des épisodes 1 et 3. Il y a bien quelques références à l’ordre, et on croise plusieurs figures connues, mais elles sont là pour situer la chronologie plus que pour imprégner l’histoire d’éléments religieux prégnants.
La quête de Travis devient rapidement une enquête, pour comprendre ce qui l’amène à Silent Hill, puis pour comprendre qui il est. Tout comme dans le 3ème opus, il n’y a que deux fins différentes (plus une fin bonus), mais elles sont plus distinctes et apportent chacune un éclairage plus cohérent que celui du 3ème épisode (qui reste excellent), et la deuxième fin est aussi marquante que perturbante. Globalement, « Silent Hill Origins » est une bonne surprise. On prend plaisir à suivre les péripéties de Travis, et on a envie de découvrir avec lui les secrets que lui soumet la ville. Le voyage est un peu trop réminescent des autres épisodes, mais le traitement est fidèle, et l’ambiance excellente.
vendredi 15 octobre 2010
Vimanarama - Bollywood par Grant Morrison
L’amateur de comics a entendu le nom de Grant Morrison au moins une fois dans sa vie. Souvent plus. Actuellement, l’auteur peut donner l’impression de diviser les foules parmi les lecteurs de Dc, certains n’hésitant pas à l’accuser d’avoir dénaturé « leur » Batman. Si on regarde les chiffres de vente de la série « Batman Et Robin », on se rend compte que les lecteurs ne sont pas si mitigés que ça, et que les détracteurs font juste beaucoup de bruit. Il n’est pas question de remettre en cause les goûts de chacun ici, mais davantage de souligner l’originalité des écrits du scénariste. Que ce soit dans des récits originaux ou en reprenant des personnages déjà existants, Morrison a toujours une quantité d’idées impressionnantes, et une identité très affirmée, qui fait qu’on reconnaît son style, sans pour autant avoir l’impression qu’il se répète.
Vimanarama est une bouffée d’air frais dans le monde des comics. Publié mensuellement en 2005, cette minisérie en trois épisodes mélange l’image que l’on peut avoir du folklore hindou à la frénésie du monde des supers héros. Alors bien sûr, trois épisodes, c’est très court, et on peut se demander si créer un nouvel univers, présenter des personnages originaux et raconter une histoire construite sera possible. Bien sûr, les arcs de trois épisodes de « Batman Et Robin » sont un condensé d’action dans lesquels l’histoire n’est jamais mise de côté. Mais on connaît déjà les personnages et le monde dans lequel ils évoluent. Avec Vinamarama, c’est une autre paire de manche.
Exit donc Gotham City, et bonjour la banlieue de Londres, où tout le monde se connaît, où les petits commerces existent encore, et où la famille a un rôle non négligeable. Pour un peu, on se croirait dans l’une de ces comédies sociales dont le Royaume Uni s’était fait une spécialité, avec ce côté intimiste, ces personnages hauts en couleurs, et la confrontation entre tradition et modernité. Le jeune héros, Ali est un garçon ordinaire, vivant au jour le jour sans se montrer remarquable. L’aspect communautaire (mais pas communautariste) est appuyé avec beaucoup d’enthousiasme par les dessins de Philip Bond. Censé dessiner We3 pour Morrison, le dessinateur a essuyé les changements de plan du scénariste (sa fable animalière ayant finalement été confiée à Frank Quitely). Son coup de crayon donne un côté vraiment attachant aux personnages, dans un style cartoon qui n’est jamais ridicule. Les traits ne sont pas réalistes, ils sont même parfois un peu géométrique, mais on est très loin des atrocités d’un Humberto Ramos qui parvient à rendre risible des scènes d’émotion censées être poignantes.
On parvient toujours à suivre l’action, les personnages sont reconnaissables, et le travail sur la couleur apporter une dimension psychédélique à l’ensemble tout à fait bienvenue. Car si tout commence de façon assez simple, les événements vont vite prendre une tournure aussi surprenante que cosmique. Un voyage au centre de la terre pour retrouver un bébé va donner lieu à la libération de démons robots dans un cadre très bollywood où une romance va naître. L’amour d’Ali pour sa promise est aussi naïf que touchant. Morrison livre un récit plein d’humour, évitant le piège du gros gag gras et teintant son histoire de petites touches drôles et subtiles. C’est ce second degré et ce refus de trop se prendre au sérieux qui donne tout son exotisme à Vimanarama. D’ailleurs, on retrouve un peu ce côté frais et attachant de la série de Matt Groening et David X. Cohen, « Futurama ». Comme dans ce dessin animé futuriste, on découvre des technologies farfelues et une galerie de personnages loufoques. Leur nombre réduit contribue grandement à l’envie de découvrir ce que l’avenir leur réserve.
Car même si le cadre de l’action est spectaculaire, le cœur du récit reste au plus près des personnages. Et ce n’est pas l’arrivée de divinités aux allures de mannequins qui vont altérer la légèreté de ton, puisqu’au contraire, entre le garçon banal et le dieu magnifique, le cœur de la jeune Sofia balancera, créant un suspense insoutenable pour le lecteur. Et mêmes ceux qui ont les happy end prévisibles en horreur se prendront à espérer une issue positive pour notre petite famille d’allumés.
Mais l’amour n’est pas la seule des préoccupations dans Vimanarama. Le père D’ali, quand la fin du monde semble imminente, s’interroge surtout sur ce qu’il va advenir de son magasin victime des événements. Son frère, Omar, beaucoup plus traditionnel, est un caractériel qui s’impose avec beaucoup de vigueur, et les politiques de Londres sont plus occupés à se vendre l’un l’autre pour gagner quelques chances de survie en plus qu’à réfléchir à un moyen de sauver le monde.
Bien sûr, la fin du monde vient secouer tout ce petit monde, et lorsqu’Ali se décide à avouer ses sentiments à sa promise, elle n’entendra rien à cause du chaos ambiant. Effet comique garanti. Entre les dialogues vifs de Morrison et les crayonnés réjouissants de Bond, Vimanarama est une petite histoire qu’on aura plaisir à parcourir encore et encore, même si sa courte durée ne lui permet pas d’être aussi mémorable que d’autres œuvres du scénariste. On regrettera d’ailleurs que le titre n’ait pas muté en série régulière, ou au moins qu’il n’y ait pas eu de suite, d’autant plus que la fin du récit s’y prête largement. Ce n’est pas tous les jours qu’on voit un dieu dévasté par un chagrin d’amour être blessé mortellement par une feuille d’arbre volant au vent. Le côté métaphysique de l’histoire donne lieu à des scènes visuellement très réussies, aux couleurs criardes mais bien mariées. Le récit prend une dimension plus sérieuse à cette occasion, et interroge tant sur la religion que sur le rapport qu’on peut avoir avec elle. Les dieux doivent-ils guider les hommes ou bien les hommes doivent-ils se saisir de ce qu’on a à leur offrir pour transcender leur potentiel ?
Plus profond qu’il n’y parait, Vimanarama est un voyage initiatique, et une réflexion sur la confrontation des générations, la place de chacun dans une famille, et la capacité de tous à s’accepter et à accepter les autres, même si leurs différences ne nous sont pas toujours agréables. Les antagonistes agressifs, réfractaires à la différence passent au second plan, illustrant les difficultés à communiquer, mais c’est vraiment l’évolution de cette petite famille qui appuie le propos de l’auteur.
Vimanarama est une œuvre surprenante, touchante, drôle, se jouant des clichés, un vrai vent de fraicheur à découvrir !
mardi 12 octobre 2010
Alan Wake - The writer
Ce 12 Octobre est marqué par la dernière extension de jeu dédiée à « Alan Wake », exclusivité xbox 360, attendue durant de longues années par les fans. Avant d’en parler, ou d’aborder l’ensemble du jeu, j’aimerais faire une parenthèse sur les fameux download limited content, les dlc.
Sur le site xbox.com, « Alan Wake : The Writer » est présenté en ces termes. :
« Tout voyage mène quelque part, et l’aventure terrifiante d’Alan Wake se termine ici. Toute question appelle une réponse, et vous la trouverez dans Alan Wake: The Writer. Ce tout nouvel opus du célèbre thriller psychologique sera disponible sur le Marché Xbox LIVE à partir du 12 octobre. Pour seulement 560 Microsoft Points…..
…Attendez-vous néanmoins à un final explosif pour cette aventure exclusive Xbox 360, dans laquelle Alan Wake cherche à faire briller la plus éclatante des lumières sur la plus formidable des obscurités. »
Si on surfe un peu sur les sites spécialisés français et qu’on lit les commentaires des lecteurs, et donc des joueurs, on découvre ce genre d’affirmations :
« Le jeu original possède déjà sa propre fin.
C'est DLC's ne sont qu'un moyen pour les fans, de prolonger l'expérience et éventuellement d'aider les joueurs à comprendre le scénario du jeu.
Mais ils ne sont pas obligatoires et ne sont pas la fin du jeu. »
Ou encore : « c'est aussi la preuve que si c'est fait un minimum intelligemment, un DLC peut trouver son public sans qu'on hurle à l'arnaque. »
Donc, de l’aveu même de l’éditeur, « The writer » conclut l’histoire de cette « première saison d’alan Wake ». Il s’agit donc bien d’une « fin en kit » comme aiment à le dire les joueurs. On ne peut en tout cas que se féliciter de ne pas voir les joueurs réagir avec virulence, et de ne pas lire de messages d’insultes à ce sujet. En effet, lorsqu’Ubisoft a sorti une extension appelée « épilogue » à son Prince Of Persia, les gens ont sorti leurs fourches, prêts à lyncher la société. Or, il s’agissait réellement d’une extension, puisqu’on avait l’opportunité de découvrir de nouvelles capacités, et donc un gameplay plus dense que dans le jeu original, et que l’expérience était plus intense et plus jouissive, renouant avec les challenges de la trilogie des sables du temps. Une fois le dlc terminé, l’histoire n’était pas plus avancée qu’à la fin du jeu original, je ne me serais donc pas senti floué si je n’avais pas eu cette extension.
De même, la foule a exprimé une colère identique en apprenant que deux séquences d’ADN d’Assassin’s Creed 2 étaient manquantes, et qu’elles seraient téléchargeables sous la forme de dlc. Ces deux épisodes n’influent pas vraiment sur le récit, et ne pas y jouer ne prive pas le joueur de la cohérence narrative du jeu original. Néanmoins, elles viennent prolonger l’expérience d’un jeu (qui à sa sortie, bénéficiait d’une durée de vie allant de 20 à 30 heures tout de même) et permettent de passer un peu plus de temps dans la peau du très charismatique Ezio.
Comment expliquer que l’accueil très vif de ces extensions n’ait pas été le même que pour celles d’Alan Wake, qui pourtant ne donne toutes les clés de son intrigue qu’au terme de ces extensions, alors que les développeurs ont bénéficié de 5 longues années pour terminer leur jeu ?
Personnellement, je comprends qu’un programmeur décide de publier des extensions sur le live, pour partager un peu plus du fruit de son travail que lorsqu’il est édité par une autre société, comme c’est le cas lorsqu’on achète un jeu sur dvd. Je ne m’en offusque pas, et chacun est libre d’acheter ou non. On peut tout à fait se contenter dans tous les cas du jeu original et estimer que son intrigue se suffit, puisque c’est généralement le cas. Même Alan Wake peut être considéré comme terminé sans ses extensions, surtout si l’on n’est pas adepte du happy end. Ce que je ne comprends pas en revanche, c’est le fait qu’on accepte une fin en kit pour le jeu de remedy, quand d’autres sociétés sont fustigées pour employer cette méthode.
Comme je l’ai déjà dit dans plusieurs de mes avis, il me semble que certains joueurs sont prompts à porter aux nues les jeux japonais et à détester les jeux américains. Ubisoft n’est pas une société américaine, mais elle n’est pas non plus japonaise. En revanche bénéficie de l’aspect exotique de la Finlande, et son côté studio indépendant lui garantit, semble-t-il une certaine impunité.
Au-delà de ce débat, la sortie de cette extension finale permet de porter un avis plus complet et plus définitif sur l’expérience de jeu qu’a constituée Alan Wake.
Mon précédent avis donnait peut-être l’impression que je n’ai pas aimé le jeu. Cela faisait longtemps que je l’attendais, et j’étais persuadé de ses qualités, en particulier du soin apporté au scénario. Ayant reçu mon édition collector, j’ai d’abord voulu lire les fameux dossiers Alan Wake avant de me plonger dans le jeu. J’ai également regardés les épisodes de la mini série Brightfalls, que j’ai trouvés brouillons, et sans grand intérêt. Contrairement au court métrage « Assassin’s Creed Lineage », dont l’intérêt pour l’intrigue du jeu était évident, je les ai en effet trouvés très dispensables.
Une fois le premier épisode du jeu lancé, j’ai immédiatement été subjugué par son atmosphère unique, à la fois onirique et cauchemardesque, envoûtante et inquiétante. Les décors, peu communs pour un jeu vidéo était d’une beauté incroyable, et j’ai pris plaisir à jouer. Mais rapidement, les limites du jeu me sont apparues : un héros fade, au ton monocorde, aux réflexions sans intérêt, et à la personnalité sans épaisseur. Les personnages secondaires n’étaient pas beaucoup plus intéressants. Barry Wheeler, le meilleur ami et agent, est une véritable caricature, censée apporter une touche d’humour, mais son côté grand guignol ampute sévèrement l’intrigue de sa crédibilité. Ecrit sans subtilité, il rassemble à lui seul une quantité inimaginable de clichés, et sa prise d’armes façon Rambo est risible. Alice, la femme perdue, celle qu’on cherche désespérément, n’est rien d’autre qu’une potiche sans profondeur. La plupart des autres personnages ne servent pas à grand-chose, et la majorité d’entre eux pourrait tout à fait ne pas faire partie du jeu sans que l’intrigue en soit diminuée.
Au fur et à mesure du jeu, qui ne s’est pas dit, dès les premières références au professeur Hartmann « tiens, ils vont nous faire le coup du : Alan a tout inventé, c’est un écrivain névrosé qui a des hallucinations » ? Qui ne s’est pas imaginé lors de la beuverie dans la cabane, que l’agent du fbi arrêterait les personnages ? Qui n’avait pas anticipé le climax, avec ce deux ex machina consistant à écrire un happy end pour sa femme, en se sacrifiant ? Enfin, qui n’avait pas compris dès le premier épisode ce qui s’était passé durant la semaine manquante de Wake ?
Ainsi, difficile de ne pas être déçu par un scénario finalement simpliste et prévisible, quand on nous avait promis un thriller psychologique ? Il n’y a d’ailleurs finalement pas grand-chose de psychologique dans ce « Alan Wake » qui peut difficilement lutter avec la profondeur d’écriture d’un « Silent Hill 2 » qui mérite davantage cette définition. Pourtant, la première nouvelle lisible dans les dossiers alan Wake était réellement intéressante et pleine de bonnes idées. Difficile de croire qu’il s’agit du même Sam Lake. Vendu avant sa sortie comme une sorte de révolution, « Alan Wake » s’appuie sur des mécaniques de jeu simples, mais aussi répétitives. Le jeu est linéaire, se présentant comme une succession de couloirs, même s’ils sont invisibles, puisqu’on évolue principalement dans la forêt. Nos ennemis sont un mélange d’apparitions fantomatiques, et de zombies, et en bons morts vivants, ils avancent inlassablement, plus inquiétant par leur nombre que par leur puissance. La répétition monotone de phrases de la vie de tous les jours renforce cet aspect de non vie. Si Wake a l’endurance d’un asthmatique, sa capacité à esquiver des attaques très vives, et à se baisser in extremis pour esquiver les coups de faux est surprenante. Alors que beaucoup ont crié au scandale en voyant un soldat entrainé baser son système de combat sur l’esquive (Alex Shepherd dans « Silent Hill Homecoming »), personne ne se plaint qu’un faible écrivain loin d’être athlétique fasse de même. Reste que le plaisir de jeu est là, et même si les situations ont tendance à se répéter, l’action est prenante. Peut être trop même, puisqu’on aurait presque l’impression de jouer à un Max Payne contre les fantômes zombies venus de la forêt, alors qu’on nous avait promis un thriller psychologique.
J’étais donc partagé au moment de télécharger la première extension, « The Signal », mais mon envie d’adorer le jeu était toujours présente. Les premières minutes me donnèrent d’ailleurs presque l’impression que l’intrigue allait trouver un souffle nouveau. Jusqu’à ce que je constate qu’il s’agissait d’un simple best off des environnements déjà explorés sans aucune innovation. Les mots à éclairer pour former les objets étaient déjà présents dans le jeu original, et leur utilisation très appuyée dans cette extension n’a rien d’innovant. Le seul véritable nouvel environnement est une cave dont l’exploration ne demande pas plus de deux minutes. Alors bien sûr, on a toujours plaisir à se plonger dans cette ambiance magistrale, mais même l’intrigue ne se renouvelle pas. Entre la fin d’Alan Wake et la fin de ce dlc, on n’apprend rien de nouveau, on peut même dire qu’on en est toujours au même point. Le twist qui se veut une exploration de l’esprit de l’auteur est une fois de plus prévisible, et sans grande profondeur.
« The Writer » apporte-t-il alors une conclusion aussi satisfaisante que salvatrice ? On ne peut que l’espérer, car malgré la déception, j’ai espéré jusqu’au bout apercevoir un sursaut de génie dans un scénario jusque-là décevant. Indépendamment des dlc, « Alan Wake » reste un jeu que j’ai apprécié, c’est même un bon jeu. Mais quand on pense à ce qu’il aurait pu être, il est difficile de ne pas se montrer un peu amer. Et c’est donc plein d’espoirs, mais aussi d’appréhensions que j’ai lancé cet ultime épisode de la saison 1. Prenant place immédiatement après « The Signal », il nous incombe, une fois encore de sortir du cauchemar créé par Wake. On a rapidement l’impression de jouer à un remake de l’épisode précédent, et on traverse, une fois encore, les décors déjà vus dans d’autres épisodes. Mais contrairement à « The Signal », « The Writer » parvient à apporter un vent de fraicheur et des idées nouvelles, qui en font rapidement l’un des épisodes les plus prenants, avec le premier, auquel il fait d’ailleurs écho. Délaissant un peu l’action que la première extension privilégiait, ce dlc repose davantage sur la narration et la mise en scène. En termes d’histoire, on a quand même vraiment l’impression de tourner en rond, et on constate que le dlc précédent ne servait strictement à rien, et qu’on aurait largement pu passer de la fin du jeu à cet épisode sans perdre d’élément d’intrigue. On nous ressert même le suspense basé sur le doute de l’équilibre psychologique de l’écrivain, avec le retour du docteur Hartman. A ce titre, le dialogue central est TRES inspiré de l’idée principale de « Silent Hill 2 ». Heureusement, il semble que cet aspect n’ait été réutilisé que pour semer une fois de plus le doute.
Mais si l’histoire ne se révèle en fin de compte pas beaucoup plus passionnante, et qu’on n’apprend pas grand-chose de plus, la mise en scène est bien plus intéressante. Dans cette même scène de dialogue notamment, le jeu des lumières, qui révèle progressivement des éléments narratifs importants donne un aspect à la fois théâtral et mystérieux tout à fait bienvenu. Le passage dans les décors sous forme de grande roue qui ne cesse de tourner est également très réussi, même s’il souligne un aspect pas franchement positif du jeu : l’idée de tourner en rond dont je parlais un peu plus tôt. Bien plus intéressant, et fait avec beaucoup plus de soins que « The Signal » cet ultime dlc est dans la bonne moyenne du jeu, et annonce la deuxième saison à venir. On prend plaisir à voyager en eaux troubles, mais l’impression très forte de déjà vu crée une frustration que la conclusion ne chassera pas. Finalement, ces deux dlcs, tout en étant des épisodes à part entière, n’apporte pas grand-chose en termes d’intrigue, et on en reste au même point qu’à la fin du jeu original : Alan doit s’échapper. Même si cette fois il semble un peu plus déterminé.
En conclusion, Alan Wake n’est pas le chef d’œuvre annoncé, le jeu révolutionnaire au scénario incroyable. Son gameplay est simple et répétitif, et l’écriture, tout en étant inégale est surtout décevante, ce qui ne permet pas de s’attacher aux personnages. On ne se sent donc pas réellement investi, et le manque d’émotion empêche l’implication. On lit souvent que les gta-like empêchent l'implication, ou du moins en diminuent l'intensité. Si je me base sur Red Dead Redemption, je trouve au contraire que la liberté de découvrir les paysages et les villes dans lesquels se déroule l'intrigue permet de s'y attacher, et de se sentir immergé. Et c'est l'un des aspects qui manque le plus à "Alan Wake". Malgré tout, il s’agit d’un bon jeu, auquel on prend plaisir à jouer, grâce à son ambiance exceptionnel, à un environnement magnifique, et une mise en scène de toute beauté. Dommage qu’il s’agisse juste d’un bon jeu.
Sur le site xbox.com, « Alan Wake : The Writer » est présenté en ces termes. :
« Tout voyage mène quelque part, et l’aventure terrifiante d’Alan Wake se termine ici. Toute question appelle une réponse, et vous la trouverez dans Alan Wake: The Writer. Ce tout nouvel opus du célèbre thriller psychologique sera disponible sur le Marché Xbox LIVE à partir du 12 octobre. Pour seulement 560 Microsoft Points…..
…Attendez-vous néanmoins à un final explosif pour cette aventure exclusive Xbox 360, dans laquelle Alan Wake cherche à faire briller la plus éclatante des lumières sur la plus formidable des obscurités. »
Si on surfe un peu sur les sites spécialisés français et qu’on lit les commentaires des lecteurs, et donc des joueurs, on découvre ce genre d’affirmations :
« Le jeu original possède déjà sa propre fin.
C'est DLC's ne sont qu'un moyen pour les fans, de prolonger l'expérience et éventuellement d'aider les joueurs à comprendre le scénario du jeu.
Mais ils ne sont pas obligatoires et ne sont pas la fin du jeu. »
Ou encore : « c'est aussi la preuve que si c'est fait un minimum intelligemment, un DLC peut trouver son public sans qu'on hurle à l'arnaque. »
| Le DLC c'est le diable |
Donc, de l’aveu même de l’éditeur, « The writer » conclut l’histoire de cette « première saison d’alan Wake ». Il s’agit donc bien d’une « fin en kit » comme aiment à le dire les joueurs. On ne peut en tout cas que se féliciter de ne pas voir les joueurs réagir avec virulence, et de ne pas lire de messages d’insultes à ce sujet. En effet, lorsqu’Ubisoft a sorti une extension appelée « épilogue » à son Prince Of Persia, les gens ont sorti leurs fourches, prêts à lyncher la société. Or, il s’agissait réellement d’une extension, puisqu’on avait l’opportunité de découvrir de nouvelles capacités, et donc un gameplay plus dense que dans le jeu original, et que l’expérience était plus intense et plus jouissive, renouant avec les challenges de la trilogie des sables du temps. Une fois le dlc terminé, l’histoire n’était pas plus avancée qu’à la fin du jeu original, je ne me serais donc pas senti floué si je n’avais pas eu cette extension.
 |
| joueurs en colère |
De même, la foule a exprimé une colère identique en apprenant que deux séquences d’ADN d’Assassin’s Creed 2 étaient manquantes, et qu’elles seraient téléchargeables sous la forme de dlc. Ces deux épisodes n’influent pas vraiment sur le récit, et ne pas y jouer ne prive pas le joueur de la cohérence narrative du jeu original. Néanmoins, elles viennent prolonger l’expérience d’un jeu (qui à sa sortie, bénéficiait d’une durée de vie allant de 20 à 30 heures tout de même) et permettent de passer un peu plus de temps dans la peau du très charismatique Ezio.
Comment expliquer que l’accueil très vif de ces extensions n’ait pas été le même que pour celles d’Alan Wake, qui pourtant ne donne toutes les clés de son intrigue qu’au terme de ces extensions, alors que les développeurs ont bénéficié de 5 longues années pour terminer leur jeu ?
Personnellement, je comprends qu’un programmeur décide de publier des extensions sur le live, pour partager un peu plus du fruit de son travail que lorsqu’il est édité par une autre société, comme c’est le cas lorsqu’on achète un jeu sur dvd. Je ne m’en offusque pas, et chacun est libre d’acheter ou non. On peut tout à fait se contenter dans tous les cas du jeu original et estimer que son intrigue se suffit, puisque c’est généralement le cas. Même Alan Wake peut être considéré comme terminé sans ses extensions, surtout si l’on n’est pas adepte du happy end. Ce que je ne comprends pas en revanche, c’est le fait qu’on accepte une fin en kit pour le jeu de remedy, quand d’autres sociétés sont fustigées pour employer cette méthode.
Comme je l’ai déjà dit dans plusieurs de mes avis, il me semble que certains joueurs sont prompts à porter aux nues les jeux japonais et à détester les jeux américains. Ubisoft n’est pas une société américaine, mais elle n’est pas non plus japonaise. En revanche bénéficie de l’aspect exotique de la Finlande, et son côté studio indépendant lui garantit, semble-t-il une certaine impunité.
Au-delà de ce débat, la sortie de cette extension finale permet de porter un avis plus complet et plus définitif sur l’expérience de jeu qu’a constituée Alan Wake.
Mon précédent avis donnait peut-être l’impression que je n’ai pas aimé le jeu. Cela faisait longtemps que je l’attendais, et j’étais persuadé de ses qualités, en particulier du soin apporté au scénario. Ayant reçu mon édition collector, j’ai d’abord voulu lire les fameux dossiers Alan Wake avant de me plonger dans le jeu. J’ai également regardés les épisodes de la mini série Brightfalls, que j’ai trouvés brouillons, et sans grand intérêt. Contrairement au court métrage « Assassin’s Creed Lineage », dont l’intérêt pour l’intrigue du jeu était évident, je les ai en effet trouvés très dispensables.
 |
| Chérie j'ai rétréci Alan |
Au fur et à mesure du jeu, qui ne s’est pas dit, dès les premières références au professeur Hartmann « tiens, ils vont nous faire le coup du : Alan a tout inventé, c’est un écrivain névrosé qui a des hallucinations » ? Qui ne s’est pas imaginé lors de la beuverie dans la cabane, que l’agent du fbi arrêterait les personnages ? Qui n’avait pas anticipé le climax, avec ce deux ex machina consistant à écrire un happy end pour sa femme, en se sacrifiant ? Enfin, qui n’avait pas compris dès le premier épisode ce qui s’était passé durant la semaine manquante de Wake ?
Ainsi, difficile de ne pas être déçu par un scénario finalement simpliste et prévisible, quand on nous avait promis un thriller psychologique ? Il n’y a d’ailleurs finalement pas grand-chose de psychologique dans ce « Alan Wake » qui peut difficilement lutter avec la profondeur d’écriture d’un « Silent Hill 2 » qui mérite davantage cette définition. Pourtant, la première nouvelle lisible dans les dossiers alan Wake était réellement intéressante et pleine de bonnes idées. Difficile de croire qu’il s’agit du même Sam Lake. Vendu avant sa sortie comme une sorte de révolution, « Alan Wake » s’appuie sur des mécaniques de jeu simples, mais aussi répétitives. Le jeu est linéaire, se présentant comme une succession de couloirs, même s’ils sont invisibles, puisqu’on évolue principalement dans la forêt. Nos ennemis sont un mélange d’apparitions fantomatiques, et de zombies, et en bons morts vivants, ils avancent inlassablement, plus inquiétant par leur nombre que par leur puissance. La répétition monotone de phrases de la vie de tous les jours renforce cet aspect de non vie. Si Wake a l’endurance d’un asthmatique, sa capacité à esquiver des attaques très vives, et à se baisser in extremis pour esquiver les coups de faux est surprenante. Alors que beaucoup ont crié au scandale en voyant un soldat entrainé baser son système de combat sur l’esquive (Alex Shepherd dans « Silent Hill Homecoming »), personne ne se plaint qu’un faible écrivain loin d’être athlétique fasse de même. Reste que le plaisir de jeu est là, et même si les situations ont tendance à se répéter, l’action est prenante. Peut être trop même, puisqu’on aurait presque l’impression de jouer à un Max Payne contre les fantômes zombies venus de la forêt, alors qu’on nous avait promis un thriller psychologique.
 |
| Je pensais avoir garé ma voiture ici, bon sang! |
« The Writer » apporte-t-il alors une conclusion aussi satisfaisante que salvatrice ? On ne peut que l’espérer, car malgré la déception, j’ai espéré jusqu’au bout apercevoir un sursaut de génie dans un scénario jusque-là décevant. Indépendamment des dlc, « Alan Wake » reste un jeu que j’ai apprécié, c’est même un bon jeu. Mais quand on pense à ce qu’il aurait pu être, il est difficile de ne pas se montrer un peu amer. Et c’est donc plein d’espoirs, mais aussi d’appréhensions que j’ai lancé cet ultime épisode de la saison 1. Prenant place immédiatement après « The Signal », il nous incombe, une fois encore de sortir du cauchemar créé par Wake. On a rapidement l’impression de jouer à un remake de l’épisode précédent, et on traverse, une fois encore, les décors déjà vus dans d’autres épisodes. Mais contrairement à « The Signal », « The Writer » parvient à apporter un vent de fraicheur et des idées nouvelles, qui en font rapidement l’un des épisodes les plus prenants, avec le premier, auquel il fait d’ailleurs écho. Délaissant un peu l’action que la première extension privilégiait, ce dlc repose davantage sur la narration et la mise en scène. En termes d’histoire, on a quand même vraiment l’impression de tourner en rond, et on constate que le dlc précédent ne servait strictement à rien, et qu’on aurait largement pu passer de la fin du jeu à cet épisode sans perdre d’élément d’intrigue. On nous ressert même le suspense basé sur le doute de l’équilibre psychologique de l’écrivain, avec le retour du docteur Hartman. A ce titre, le dialogue central est TRES inspiré de l’idée principale de « Silent Hill 2 ». Heureusement, il semble que cet aspect n’ait été réutilisé que pour semer une fois de plus le doute.
 |
| Si on vous le dit, c'est que c'est vrai! |
Mais si l’histoire ne se révèle en fin de compte pas beaucoup plus passionnante, et qu’on n’apprend pas grand-chose de plus, la mise en scène est bien plus intéressante. Dans cette même scène de dialogue notamment, le jeu des lumières, qui révèle progressivement des éléments narratifs importants donne un aspect à la fois théâtral et mystérieux tout à fait bienvenu. Le passage dans les décors sous forme de grande roue qui ne cesse de tourner est également très réussi, même s’il souligne un aspect pas franchement positif du jeu : l’idée de tourner en rond dont je parlais un peu plus tôt. Bien plus intéressant, et fait avec beaucoup plus de soins que « The Signal » cet ultime dlc est dans la bonne moyenne du jeu, et annonce la deuxième saison à venir. On prend plaisir à voyager en eaux troubles, mais l’impression très forte de déjà vu crée une frustration que la conclusion ne chassera pas. Finalement, ces deux dlcs, tout en étant des épisodes à part entière, n’apporte pas grand-chose en termes d’intrigue, et on en reste au même point qu’à la fin du jeu original : Alan doit s’échapper. Même si cette fois il semble un peu plus déterminé.
 |
| Quelle tristesse ce manque d'émotion |
En conclusion, Alan Wake n’est pas le chef d’œuvre annoncé, le jeu révolutionnaire au scénario incroyable. Son gameplay est simple et répétitif, et l’écriture, tout en étant inégale est surtout décevante, ce qui ne permet pas de s’attacher aux personnages. On ne se sent donc pas réellement investi, et le manque d’émotion empêche l’implication. On lit souvent que les gta-like empêchent l'implication, ou du moins en diminuent l'intensité. Si je me base sur Red Dead Redemption, je trouve au contraire que la liberté de découvrir les paysages et les villes dans lesquels se déroule l'intrigue permet de s'y attacher, et de se sentir immergé. Et c'est l'un des aspects qui manque le plus à "Alan Wake". Malgré tout, il s’agit d’un bon jeu, auquel on prend plaisir à jouer, grâce à son ambiance exceptionnel, à un environnement magnifique, et une mise en scène de toute beauté. Dommage qu’il s’agisse juste d’un bon jeu.
dimanche 10 octobre 2010
I Sell The Dead
Quiconque a suivi la série « Lost » ne peut que se réjouir de retrouver l’acteur Dominic Monaghan le temps d’un film. Cela dit, j’ai remarqué qu’en France, on avait du mal à retenir les noms des acteurs quand ils n’ont pas le statut de star. Donc on ne peut que se réjouir de retrouver le petit barbu à la tête de hobbit qui joue dans la série où ils sont perdus sur l’île et qui a la voix française de Nikki Larson. Quand Ron Perlman (le grand type à la tête bizarre qui jouait un diable avec un gros pétard) et des zombies s’ajoutent à l’équation, il n’y a plus à hésiter.

« I Sell The Dead » est une petite production britannique sans prétention. Cela ne veut pas dire pour autant qu’il s’agit d’un produit bâclé. Le générique, composé d’illustrations morbides et d’inscriptions manuscrites à base de flots de sang et de squelettes est fortement connoté Angleterre victorienne. Cette recherche visuelle se retrouve dans le soin apporté aux décors et aux costumes. Cette reproduction de qualité assure une immersion immédiate. On sent que le budget est limité, le nombre de décors restant faible tout au long du film, mais l’équipe livre un travail remarquable et utiliser les moyens à sa disposition de façon très astucieuse.
Ainsi, c’est la narration qui donne du relief à une histoire qui ressemble plus à une succession de saynètes qu’à une intrigue suivant un véritable fil rouge. Cette forme déstructurée fait penser à la construction épisodique d’une série tv, ce qui n’est pas gênant, car on alterne ainsi avec les commentaires du héros dont on suit la vie. C’est en effet sous la forme d’une confession que s’articule l’intrigue. Dominic Monaghan, qui joue le pilleur de tombes Arthur Blake, attend d’être décapité en discutant avec un moine un rien agressif joué par Ron Perlman. L’alchimie entre les acteurs est évidente, instillant une dynamique très amusante entre leurs personnages.

L’ensemble des acteurs se livre à une prestation outrancière et drôle, où l’humour est le maître mot. Le duo principal fonctionne d’ailleurs parfaitement, ce qui était un élément indispensable à la réussite du film. Mais c’est surtout Dominic Monaghan qui remporte l’adhésion, en se montrant très à l’aise dans un rôle comique. Sans jamais trop en faire (même s’il lui arrive volontairement de grimacer) il parvient à donner vie à un personnage roublard mais sympathique.
Les aventures, ou plutôt les tribulations de son Arthur Blake ressemblent fort à une succession de contes, mais l’opposition entre le parcours de vie et les événements surnaturels donner une atmosphère surréaliste bienvenue. Il faut dire que nos deux compères vont faire des rencontres pour le moins insolites. Une grande majorité des scènes se déroule au milieu des tombes, le cadre se prêtant plus facilement à l’irruption du surnaturel. Et sans surprise, les morts refuseront de rester sous terre. Mais les vampires et autres zombis ne constituent pas l’essentiel du menu, et notre duo rencontrera des êtres dont la présence est encore plus inhabituelle. Ces situations donnent lieu à du comique de situation de type slapstick. Les acteurs sont d’ailleurs tout à fait dans le ton, livrant des prestations énergiques sans jamais tourner leur personnage en ridicule.

Et en effet, l’humour est largement privilégié. D’ailleurs, « I sell The Dead » fait davantage penser à un conte d’Halloween qu’à un vrai film d’horreur. L’hémoglobine n’est malgré tout pas absente, puisque les quelques zombies se font les dents dans un final haut en couleurs. On arrive d’ailleurs vite à cette conclusion malgré l’aspect décousu de l’intrigue. La bonne humeur de l’ensemble est communicative, grâce à l’énergie de l’équipe. La musique jour tout à fait son rôle de ce point de vue, en privilégiant notamment des mélodies irlandaises dans l’âme et dignes de figurer dans les fêtes de pub les plus folles. Techniquement, le film reste soigné du début à la fin, en évitant de multiplier les décors, mais en arrangeant ceux qu’on voit avec minutie. On notera aussi des effets de montage très sympathiques, comme cette scène de présentation de tueurs en série avec des portraits animés. Ainsi, le budget n’est jamais un frein, et l’ingéniosité de l’équipe fait de « I Sell The Dead » plus qu’un petit film comme on en trouve à la pelle.

Pas un pur film de zombies, mais une comédie horrifique enthousiasmante, à voir !
jeudi 7 octobre 2010
Silent Hill 4 - The Room
Dernier épisode créé par l’équipe d’origine, « silent Hil 4 : The Room » n’est pas l’épisode préféré des fans. Il conservera malgré tout une place à part pour moi, car il représente ma première confrontation à la fameuse ville. On suit les mésaventures du personnage le plus fade de la saga, l’insipide Henry Towsend. Le pauvre bougre est enfermé chez lui depuis plusieurs jours lorsque le jeu débute. La porte d’entrée est enchainée de l’intérieur, les fenêtres sont closes, et les liens avec l’extérieur comme la télévision ou le téléphone ne fonctionnent pas. De plus, un mot menaçant intime à notre protagoniste de ne pas sortir. Lorsqu’on prend le contrôle, un trou s’est creusé dans le mur de sa salle de bain, formant un tunnel.

Le jeu se découpe en deux phases distinctes : les passages dans l’appartement, et les sorties dans les dimensions parallèles. Lorsque Henry est chez lui, on le dirige en vue à la première personne. On peut espionner ses voisins par le judas de la porte ou par des trous dans les murs, comme le parfait petit voyeur. Les fenêtres donnent un aperçu de la vie à l’extérieur, où l’activité semble importante, sans jamais qu’on puisse communiquer, renforçant l’impression d’être prisonnier de son propre appartement. Ce cachot constitue également un lieu d’accalmie, en opposition aux dimensions parallèles où le danger est permanent. On prend d’ailleurs rapidement l’habitude de s’accorder des moments de répit pour entretenir un sentiment de sécurité de plus en plus illusoire.
On n’ira jamais vraiment dans Silent Hill, mais l’influence de la ville est telle qu’on se croit sur place. D’ailleurs, certains endroits présentent une structure similaire, l’appartement de Henry rappelant furieusement ceux que l’on visite dans le deuxième opus. Le protagoniste, catapulté au mauvais endroit au mauvais moment, n’est qu’un témoin des événements, ce qui limite l’investissement émotionnel, puisque dans les trois premiers jeux, c’était toujours l’histoire personnelle du héros qui structurait le récit. On a ainsi du mal à s’attacher à cet homme transparent, sans passé, sans histoire, qui subit les événements sans réagir, et c’est plutôt du côté des seconds rôles qu’on trouvera des personnages charismatiques.

La narration est fragmentée, même si le découpage en chapitres n’est pas explicite. Au lieu de passer d’un endroit de la ville à l’autre en déambulant dans les rues, c’est l’ouverture de la salle de bain qui nous transporte automatiquement dans un nouveau lieu lorsqu’on a accompli toutes les tâches dans le précédent. Métro, parc, donjon, immeubles et hôpital seront les destinations qui nous amèneront à rencontrer d’autres âmes perdues. Chaque lieu livrera un fragment d’intrigue, un indice sur le mystérieux Walter Sullivan, dont le nom n’est pas étranger à ceux qui ont joué au deuxième opus, et qui veut nous empêcher de quitter notre appartement. Les lieux que l’on visite, dont certains sont fréquentés quotidiennement par Henry, sont soumis aux distorsions spécifiques à la dimension parallèle de Silent Hill. Les événements qui s’y déroulent ont une influence directe sur le monde réel. On verra par exemple, à travers la fenêtre de l’appartement, une ambulance devant l’entrée du métro, après qu’un drame y ait eu lieu dans la dimension parallèle. Si on rencontre des monstres, ils sont loin d’être la seule source de danger.
En effet, la quête de Henry va l’amener à croiser régulièrement Walter dans les autres dimensions, véritable figure fantomatique, qui va progressivement envahir l’ensemble des lieux, jusqu’à l’appartement de Henry, où des esprits vont se manifester. On trouve régulièrement des références aux précédents épisodes, l’intrigue étant plus ou moins lié à l’ordre religieux qui sévit à Silent Hill. Et même s’il n’est pas question de la résurrection d’un dieu, l’occulte occupe une place très importante.

L’intrigue est d’ailleurs surprenante, car plus touchante qu’on pourrait le croire. C’est malgré tout le malsain qui prime, que ce soit en termes d’histoires, de graphismes, ou de sons. A ce titre, à la manière du 3ème opus, « The Room » est un des jeux marquants de cette génération de consoles, offrant un rendu visuel prenant. Les musiques sont comme d’habitude très réussies, en particulier la chanson « Room Of Angels », même si elle est exploitée maladroitement.
Véritablement prenant, « Silent Hill 4 » n’est pas exempt de défauts. Après avoir exploré les différents lieux, on doit à nouveau en visiter une version moins grande. Ce caractère redondant est un peu pénible et ne semble avoir pour unique but que d’allonger la durée de vie du jeu. Lorsqu’arrive l’affrontement final, on comprend que l’équipe a plus misé sur les seconds rôles que sur le héros pour assurer un investissement émotionnel. Et ça fonctionne, puisque la course contre la montre que constitue ce dernier combat est épuisante. Les fins multiples ne modifient pas la compréhension qu’on peut avoir de l’histoire, mais diffèrent de façon intéressante. C’est la fin négative qui reste la meilleure, avec son arrière goût amer et sa résolution terrible et perturbante.

« Silent Hill 4 : the Room » est un épisode à part, qui s’éloigne de la formule originale tout en conservant l’esprit de la série pour un résultat envoûtant.
mardi 5 octobre 2010
Undead
Si le cinéma australien n’est pas des plus connus en France, il a su nous offrir quelques films remarquables, comme « Priscilla, folle du désert », ou le western crépusculaire « The proposition » de John Hillcoat. On a vu beaucoup de zombies américains, un certain nombre de zombies italiens, des zombies asiatiques (japonais, hong kongais et même thaïlandais), des zombies espagnols (les morts-vivants templiers de Ossario), et même des zombies français (« Paris by night of the living dead », « la horde).

Voilà à présent les zombies australiens. Tourné avec un budget risible, « Undead » ne trahit pourtant jamais ses limites et fait même largement illusion. Le savoir faire technique des deux frères réalisateurs est indéniable, et la mise en image, bourrée d’idées (principalement recyclées d’autres films cependant) n’a pas à pâlir face à des productions plus prestigieuses.

Le projet est donc ambitieux. L’intrigue se déroule dans un bled rempli de rednecks, et l’un des protagonistes est un paysan aussi exagérément ténébreux que surarmé. D’ailleurs, les personnages sont plus iconiques qu’écrits, un constat qui s’applique à l’ensemble de l’intrigue. On remarque un certain nombre de scènes potentiellement cultes, mais le tout manque de cohésion. La structure narrative laisse à désirer, et quelques longueurs subsistent. De plus les clichés du genre sont tous exploités, comme les disputes dans le groupe, le passage claustrophobique dans un abri et des dialogues pas vraiment affutés.
Les acteurs sont des amateurs, et cela se ressent, mais contrairement à la plupart des productions de ce genre, ils se donnent à fond et essaient réellement de jouer la comédie. Malgré un scénario brouillon et quelques passages longuets, « Undead » possède quelques atouts appréciables. Les affrontements avec les morts-vivants sont jouissifs. Très ancrés dans la culture post-matrix, ils mettent en scène des acrobaties très proches de ce qui se fait dans le cinéma de Hong Kong. Et si on fait surtout parler la poudre, quelques armes de fortune tranchantes seront à l’origine de cascades d’hémoglobine tout à fait réussies.

Les zombies sont bien véloces, et on a même le droit à une attaque de poissons morts-vivants inoubliable. Mais ce ne sont pas les seules créatures surnaturelles que nos héros vont rencontrer. Comme le laissait augurer le météore à la base de l’invasion, des extraterrestres vont faire leur apparition. Leur présence va donner lieu à l’un des passages les plus réussis visuellement, avec une mise sous quarantaine surprenante. Le 2nd degré est de rigueur, mais malgré quelques sourires, on ne peut pas dire que « Undead » soit désopilant au point de s’étouffer avec son pop-corn.

Si on regrettera une longueur excessive pour un tel sujet, l’ensemble est suffisamment inventif pour occuper agréablement la soirée.
Inscription à :
Articles (Atom)