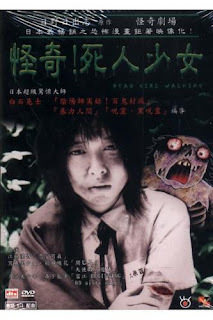En 2003, le genre du film de super-héros est en plein boom, et c’est Marvel qui mène la danse grâce à ses adaptations de Spider-man, et des X-men. Les deux franchises ont employé les services de professionnels du cinéma de Hong Kong afin de chorégraphier des combats percutants, mais c’est avant tout le sérieux des réalisateurs qui a permis à ces films d’obtenir une légitimité auprès du grand public, attirant dans les salles obscures bien plus de monde que le simple groupe des lecteurs de comics. Créé en 1964 par Stan Lee, Daredevil est un héros qui ne connaît pas la même renommée internationale que l’homme araignée où l’équipe de mutant, ni même celle du géant vert Hulk. Et si la bande dessinée n’a pas connu la constance en termes de ventes de titres plus connus, le personnage reste très apprécié. Rédigé à l’origine comme un homme sans peur, dont la seule crainte est de ne pas gagner le cœur de sa belle, le diable en collants va connaître une seconde jeunesse dans les années 80, sous la plume de Frank Miller. D’abord dessinateur, c’est en devenant scénariste sur la série que Miller va se faire un nom, et permettre à Daredevil de rentrer dans la cour des grands. Grand amateur du cinéma asiatique, l’auteur va insuffler un découpage cinématographique à ses histoires, instillant une véritable atmosphère de film noir. Le fameux quartier de Hell’s Kitchen, dont le véritable nom est Clinton, va prendre vie sous sa plume, avec ses ruelles sombres et ses bars repaires à gangsters (le fameux bar de Josie, qui apparaît d’ailleurs dans le film). Il aura fallu attendre presque 40 ans pour que les aventures de l’avocat justicier soient portées à l’écran, mais ce n’est pas sa première apparition dans un film, puisqu’en 1989 Rex Smith l’incarnait déjà dans le téléfilm Le Procès De L’Incroyable Hulk. Pour cette première aventure cinématographique qui voit Daredevil œuvrer en tant que héros principal, il est important de se procurer la version du réalisateur, qui donne une autre ampleur au récit. La version cinéma n’est qu’un brouillon sans âme, sans vision, et sans cohérence narrative alors que le montage original, sans être inoubliable, est loin d’être dénué de qualités.
Le succès des récits de Kevin Smith ou Brian M. Bendis pouvaient laisser supposer qu’ils serviraient de base à cette adaptation, mais ce sont finalement les écrits de Frank Miller qui seront davantage utilisés pour introduire le personnage. Certaines, largement édulcorées, seront même directement reprises de l’épisode culte 182 du comics, qui voit les personnages d’Elektra et Bullseye, respectivement ennemie amante et pire ennemi du héros, s’affronter à mort. Il s'agit cependant d'une réelle adaptation, dans le sens où le réalisateur a réécrit le scénario, en essayant de garder les éléments importants de la bande dessinée, pour créer une autre histoire en quelque sorte, tout en essayant de rester fidèle à l'esprit original (du moins l'esprit de Daredevil période Miller). Ainsi, les circonstances de la rencontre de Matt et Elektra vont prendre une toute autre tournure et ne se déroulent pas à la fac, puisque Matt est déjà avocat. Ce parti-pris pourrait se justifier s’il n’était pas à la base de la scène la plus navrante du film qu’on retrouve malheureusement même dans le director’s cut. De même les circonstances de la mort du père d'Elektra sont tout à fait différentes. Malgré ces divergences, les relations sont assez respectueuses de celles instaurées dans le comic, et certaines scènes parviennent réellement à recréer l'ambiance (l'enterrement entre autres, réussit à être très proche, tant en terme d’ambiance que visuellement, de ce qu’on pouvait lire à l’époque...). Certains passages forts sont gardés, les éléments principaux sont respectés, donc le réalisateur parvient à conserver l'esprit de la bande dessinée en essayant de développer une vision personnelle. Malheureusement, le scénario n’est pas toujours respectueux de l’essence du personnage, comme on peut le constater lorsqu’il exécute un malfrat. Si Batman tuait à ses débuts, ça n’a jamais été le cas de Daredevil. On peut tout au plus imputer une mort plus ou moins accidentelle au héros à la fin des années 70, mais il n’a jamais tuer de sang froid et exècre le meurtre.
On peut voir dans ce choix scénaristique douteux la volonté de montrer le cheminement psychologique qui a fait du héros ce qu'il est. On retrouve en ce sens la démarche de Frank Miller pour Batman Year One, sauf que dans cette bande dessinée, le héros n'en arrivait pas à tuer pour comprendre qu'il ne devait pas franchir la ligne. On regrettera aussi certains choix de casting regrettables: Colin Farrell est risible en Bullseye, et n'a rien à voir avec le personnage. Jennifer Garner, pure californienne, n'a non seulement pas le physique d'une guerrière Grecque, mais ne parvient à faire passer ni la rage, ni la puissance d'un personnage aussi édulcoré qu’insipide. Quant à Ben Affleck, il livre une prestation sans éclat, sans passion, et sans conviction. Ce sont finalement les seconds rôles les moins développés qui parviennent le mieux à convaincre. Ainsi, John Favreau donne vie à Foggy Nelson, lui insufflant bonhommie et jovialité, alors que le personnage reste peu écrit. Il y a néanmoins une véritable alchimie entre lui et le héros, notamment lors d’une scène de procès amusante. Michael Clarke Duncan se révèle quant à lui impressionnant dans le rôle du caïd du crime, on regrettera juste qu’il ne soit pas plus machiavélique. Le fait de mêler son destin à celui d’un tout jeune Matt Murdock ressemble à un hommage au Batman de Tim Burton, et n’apporte finalement pas grand-chose à l’intrigue. Reste que cette version du chef de la pègre s'inscrit intelligemment dans la dynamique du personnage, l'apport des origines du Bronx collant tout à fait à l'esprit du personnage. Et Duncan se révèle à la hauteur du charisme animal du caïd. La référence à Tim Burton n’est sans doute pas anodine, car Daredevil est un film à hommage. Les clins d'œil aux différents auteurs de la bd sont bien trouvés (Quesada, Romita....mais on retiendra surtout une apparition éclaire de Frank Miller en personne, en plus du traditionnel caméo de Stan Lee), et l'ambiance sombre de l'ensemble est assez représentative du personnage. Bien sûr, quand on sait que Christopher Nolan devait réaliser ce film avec Guy Pearce dans le rôle titre, on ne peut qu'émettre certains regrets. Mais cette version director's cut, si elle ne joue absolument pas dans la même cour que les Batman de Christopher Nolan, est loin d’être aussi ratée que pourrait le laisser penser la version cinéma. On appréciera particulièrement le procès, qui manque à la version cinéma, et donne enfin une cohérence à l’histoire, tout en la rendant nettement plus intéressante. La place accordée aux personnages secondaires est également l'une des bonnes surprises, et l'un des défauts corrigés par rapport à la version cinéma. Elektra a une place beaucoup moins importante, l'intrigue se révélant prioritaire sur la romance dans cette version, ce qui paraît plus cohérent, tout en étant moins grand public. A ce titre, le réalisateur parvient à éviter le cliché présent dans la version cinéma et allant à l’encontre des règles du héros : cette fois il privilégie son devoir à l’amour, et les fans sont rassurés. L’histoire ne devient pas inoubliable, et les personnages n’ont pas une psychologie inouï, mais le résultat est bien plus réussi.
On peut voir dans ce choix scénaristique douteux la volonté de montrer le cheminement psychologique qui a fait du héros ce qu'il est. On retrouve en ce sens la démarche de Frank Miller pour Batman Year One, sauf que dans cette bande dessinée, le héros n'en arrivait pas à tuer pour comprendre qu'il ne devait pas franchir la ligne. On regrettera aussi certains choix de casting regrettables: Colin Farrell est risible en Bullseye, et n'a rien à voir avec le personnage. Jennifer Garner, pure californienne, n'a non seulement pas le physique d'une guerrière Grecque, mais ne parvient à faire passer ni la rage, ni la puissance d'un personnage aussi édulcoré qu’insipide. Quant à Ben Affleck, il livre une prestation sans éclat, sans passion, et sans conviction. Ce sont finalement les seconds rôles les moins développés qui parviennent le mieux à convaincre. Ainsi, John Favreau donne vie à Foggy Nelson, lui insufflant bonhommie et jovialité, alors que le personnage reste peu écrit. Il y a néanmoins une véritable alchimie entre lui et le héros, notamment lors d’une scène de procès amusante. Michael Clarke Duncan se révèle quant à lui impressionnant dans le rôle du caïd du crime, on regrettera juste qu’il ne soit pas plus machiavélique. Le fait de mêler son destin à celui d’un tout jeune Matt Murdock ressemble à un hommage au Batman de Tim Burton, et n’apporte finalement pas grand-chose à l’intrigue. Reste que cette version du chef de la pègre s'inscrit intelligemment dans la dynamique du personnage, l'apport des origines du Bronx collant tout à fait à l'esprit du personnage. Et Duncan se révèle à la hauteur du charisme animal du caïd. La référence à Tim Burton n’est sans doute pas anodine, car Daredevil est un film à hommage. Les clins d'œil aux différents auteurs de la bd sont bien trouvés (Quesada, Romita....mais on retiendra surtout une apparition éclaire de Frank Miller en personne, en plus du traditionnel caméo de Stan Lee), et l'ambiance sombre de l'ensemble est assez représentative du personnage. Bien sûr, quand on sait que Christopher Nolan devait réaliser ce film avec Guy Pearce dans le rôle titre, on ne peut qu'émettre certains regrets. Mais cette version director's cut, si elle ne joue absolument pas dans la même cour que les Batman de Christopher Nolan, est loin d’être aussi ratée que pourrait le laisser penser la version cinéma. On appréciera particulièrement le procès, qui manque à la version cinéma, et donne enfin une cohérence à l’histoire, tout en la rendant nettement plus intéressante. La place accordée aux personnages secondaires est également l'une des bonnes surprises, et l'un des défauts corrigés par rapport à la version cinéma. Elektra a une place beaucoup moins importante, l'intrigue se révélant prioritaire sur la romance dans cette version, ce qui paraît plus cohérent, tout en étant moins grand public. A ce titre, le réalisateur parvient à éviter le cliché présent dans la version cinéma et allant à l’encontre des règles du héros : cette fois il privilégie son devoir à l’amour, et les fans sont rassurés. L’histoire ne devient pas inoubliable, et les personnages n’ont pas une psychologie inouï, mais le résultat est bien plus réussi.
Et même avec ces 30 minutes supplémentaires, le film est assez rythmé. Les scènes d'action sont assez inégales, certaines sont de bon niveau, d'autres moins, et on peut parfois regretter l'utilisation d'images de synthèse, mais elles sont plutôt divertissantes dans l'ensemble. Il faut savoir que les chorégraphies sont réparties entre Yuen Cheung Yan, pour les duels, et Jeff Imada pour les affrontements de groupe et le final contre le caïd. De même, les combats sont dans le style de ce qui se fait à Hong Kong, non pas par effet de mode uniquement, mais parce que dès le début des années 80, Miller introduit les arts martiaux (par le biais d'Elektra et d'une secte de ninja nommée "la main" qu'on ne voit pas dans le film). Ainsi, dès cette période, les scènes d'action du comics mettent en avant les arts martiaux et les acrobaties, ce qui explique en partie les chorégraphies. De façon surprenante, les combats chorégraphiés par Yuen Cheung Yan sont les moins réussis. Toutefois, pour réellement juger de son travail, il est important de regarder le making off qui présente le résultat d’origine, joué par des cascadeurs de Hong Kong, et le rendu final, interprété mollement par Affleck et Garner. Le duel dans l’église entre le héros et Bullseye est également décevant, notamment à cause de son utilisation abusive des effets spéciaux. Si ce choix parait légitime pour les acrobaties d’un spider-man, le côté plus combat de rue des aventures de Daredevil le justifie moins. Finalement, Jeff Imada, dans une approche plus réaliste, livre un travail qui n’est pas inoubliable, mais dont la brutalité est plus percutante. D’autant plus que de nombreux plans, très brutaux, sont ajoutés dans cette version et procurent une dynamique qui manquait à certains combats. Le combat dans le bar est par exemple plutôt jouissif, mêlant la violence d’un passage à tabac et le spectaculaire d’un pur combat de comic. Mais l'affrontement Daredevil/Caïd reste plus percutant. Beaucoup plus long et violent dans cette version, on a enfin droit à un final digne de ce nom, dans lequel les antagonistes s’attaquent à coups de têtes, de directs en pleine mâchoire… Ces deux combats restent les plus jouissifs du film et laissent une bonne impression, alors que les autres paraissent trop chorégraphiés. La réalisation, si elle se révèle parfois approximative dans certaines scènes d'action, reste assez dynamique, avec quelques beaux cadrages et effets de lumière. On sent une volonté de créer un univers à mi-chemin entre le réalisme urbain et des couleurs très travaillées dans un style purement comics.
Daredevil n’est pas un grand film, mais si on se base sur sa version director’s cut, il est loin d’être le gâchis tant décrié. Un divertissement honorable mais plutôt anecdotique en somme.